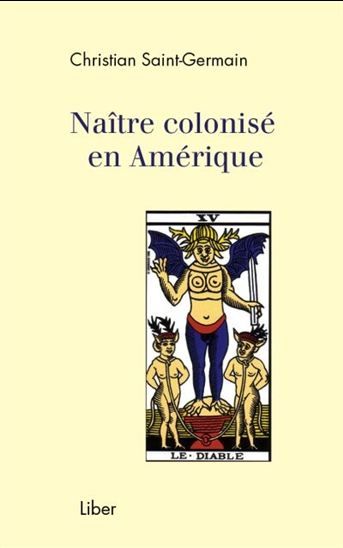Christian Saint-Germain a l’écriture jubilatoire. Après L’avenir du bluff québécois et Le mal du Québec, parus en 2015 et en 2016, il vient de faire paraître Naître colonisé en Amérique (Liber, 2017), un pamphlet drôle, corrosif, outrancier, et qui pourtant, souvent, trop souvent, vise juste dans le portrait d’une société en état de décomposition avancée. Saint-Germain demeure fidèle à son projet des dernières années, soit démystifier la Révolution tranquille et jeter à terre le parti qui l’incarne jusqu’à caricaturer ses défauts: le Parti Québécois. On aura beau se faire accroire que le Québec s’est émancipé depuis 57 ans maintenant, Saint-Germain ramène une thèse présente dans les deux derniers livres qu’il place désormais au centre de son ouvrage: nous serions toujours des colonisés en Amérique. Mais pour en prendre conscience, il faut dissiper les légendes qui embrouillardent l’espace public. C’est à l’examen de cette condition aussi misérable qu’inavouée qu’il s’emploie sur plus de 200 pages. Disons-le dès maintenant: si Saint-Germain est philosophe de profession, c’est aussi un écrivain de vocation et une des voix les plus singulières du Québec d’aujourd’hui.
Comme d’habitude avec Saint-Germain, le livre commence avec un derby de démolition. On le lit en riant méchamment. Cette fois, il s’en prend au système médiatique québécois qu’il n’admire manifestement pas, et personne, ou à peu près personne, n’en sort indemne, qu’il s’agisse des grands ou petits animateurs du landerneau médiatico-politique. De Denis Coderre à Gérard Bouchard en passant par Philippe Couillard, ils passent tous à la varlope. Et cela, sans oublier les médiatiques au sens propre. Il faut dire que Saint-Germain sait faire rire cruellement et n’hésite pas à frapper sur les puissants, et s’il grossit le trait en les caricaturant, on reconnaît la plupart du temps les personnages dans leur portrait littéraire. On commence presque à s’y habituer et pourtant, on en demande encore: il nous peint une comédie québécoise qui ferait pleurer si elle ne faisait autant rire. Nous sommes dans une société où rien ne fonctionne, où les médias taisent ce qui se passent plutôt que de le raconter intelligemment, où l’éducation tolère l’analphabétisme, où la loi 101 sur laquelle repose apparemment tout notre avenir linguistique peine à fabriquer des Québécois et où les médecins sont désormais invités à suicider les gens dans la dignité.
Mais surtout, nous sommes dans un pays où les souverainistes ne font pas l’indépendance tout en nous faisant croire qu’ils la font très subtilement. Saint-Germain est sans pitié pour le Parti Québécois dont il souhaite la mort la plus brutale, la plus humiliante, comme s’il fallait d’abord s’en débarrasser pour que l’avenir devienne possible. Saint-Germain ne manque aucun chef péquiste: chacun à sa manière se serait comporté comme un nain provincialiste incapable de penser vraiment la libération d’un peuple. La «fine équipe des provinciaux déguisés en hommes d’État» (p.104) ne mériterait pas les hommages qui lui rituellement rendu. Mais nous serions rendus au stade final du péquisme crépusculaire, et Jean-François Lisée aurait, bien qu’il en soit inconscient, la triste charge de provoquer l’explosion de son parti lors des élections de 2018. Il serait en fait la victime sacrificielle par excellence. Articulé, intelligent, brillant, dépassant d’une tête ou deux tous ceux qui l’entourent, Lisée serait un surdoué en politique. Mais il appartiendrait au vieux monde péquiste, il l’incarnerait jusqu’au bout des ongles. Sa défaite sera la «dissolution finale» (p.49). Saint-Germain va jusqu’à écrire à l’avance, dans un style exagérément cabotin, la lettre de démission de Lisée qui suivra l’échec de 2018. Ce ne sont pas les meilleures pages du livre.
Le PQ doit donc mourir pour que l’indépendance renaisse – pour l’instant, cette dernière ne serait que du «similipoulet souverainiste de cafétéria» (p.44). Car Saint-Germain en est persuadé: girait au fond de la culture québécoise une aspiration presque mystique à la renaissance nationale, mais pour cela, il ne faudrait pas qu’un leader indépendantiste prenne le peuple comme il est mais «l’invente» (p.94) par un grand geste politique capable de transfigurer son destin et de l’arracher à une histoire ratatinée. Le rêve que Saint-Germain croit apercevoir dans la conscience historique, ce n’est «rien de moins qu’une France nouvelle arrachée à sa gangue d’intendants retournés en catastrophe après la Conquête et finalement décortiquée de son enveloppe historique européenne rancie» (p.105). Saint-Germain parle aussi de la «pureté révolutionnaire essentielle à l’avènement d’un État français en Amérique» (p.81). Disons la chose en d’autres mots, peut-être un peu moins lyriques: il ne peut pas y avoir de politique indépendantiste sans mystique indépendantiste. Il ne peut pas y avoir de nation sans mystique nationale, et les Québécois qui ont oublié l’épopée de l’Amérique française seraient aujourd’hui en manque de mystique. Il y a quelque chose de sacré dans la poursuite de l’indépendance d’un peuple. On retrouve ici ce qu’on pourrait appeler la posture prophétique de Saint-Germain: alors que tous les nationalistes s’inquiètent d’un effondrement du parti indépendantiste, lui veut voir dans ce cataclysme possible un moment de renaissance. C’est en mourant qu’on peut renaître. On peut voir les choses autrement. il ne pourrait y avoir que le néant.
Le titre de Saint-Germain est clair: les Québécois seraient colonisés. Ils n’auraient jamais cessé de l’être, mais rares sont ceux qui, dans l’histoire, auraient osé regarder cette réalité en face. Miron aurait eu ce courage, Aquin aussi, et on en trouvera aisément quelques autres. Mais la pensée québécoise aurait esquivé cette réalité, trop difficile à assumer: les Québécois seraient colonisés jusqu’au trognon. Les Québécois achèteraient l’idéologie canadienne sans se rendre compte qu’elle les neutralise politiquement : «Outil normatif supposément neutre, la charte canadienne suscite autant une apparence de droits fondamentaux bafoués qu’elle laisse entendre à une minorité de survivants qu’ils sont une majorité pérenne ou intolérante» (p.37). Le Canada qu’on nous vend est un délire idéologique auquel prêteraient allégeance ceux qui troqueraient leur identité pour une situation. «Être canadien, c’est une manière d’inexistence culturelle dans le bruissement stéréo de la mondialisation et de l’effacement mercantile des identités nationales. Pour quiconque connaît la profondeur de la culture française c’est une manière d’internement dans un Radio Shack, un Canadian Tire, un entrepôt avec des palettes de beurre de peanut et des piscines hors terre soldées. Qui peut prétendre sans subvention avoir envie d’être canadien et de bénéficier des délicates attentions de la Loi sur les Indiens?» (p.135).
Si Saint-Germain est si violent dans sa description de la comédie québécoise, c’est probablement parce qu’il veut fracasser un dispositif idéologique très puissant qui empêche les Québécois de prendre pleinement conscience de leur condition collective. Il faut parler très fort dans une société qui fait des efforts pour ne pas comprendre ce qui lui arrive. «Heureusement qu’on était sorti de la grande noirceur» (p.24). On comprend que pour Saint-Germain, nous y sommes encore et à le lire, bien souvent, on a envie de lui donner raison. Le simulacre de débat public dans lequel nous évoluons, où les faux-penseurs se permettent un débat amidonné en se tenant bien serrés dans le périmètre d’un politiquement correct médiatiquement surveillé devient vite étouffant pour quiconque veut penser librement sans se soumettre à l’orthodoxie du jour. Peut-être est-ce pour cela aussi que Saint-Germain parle de notre époque comme d’une «toute nouvelle noirceur» (p.194). Les Québécois se croient délivrés de leurs tares historiques alors qu’ils ne le sont pas. La vision qu’ils ont d’eux-mêmes est simplement fausse.
Insistons un peu puisqu’il insiste lui-même beaucoup sur la question: la Révolution tranquille serait un désastre maquillé en émancipation: elle aurait réduit un peuple en communauté de grabataires vampirisés par des médecins cupides. Cette société qui au fond d’elle-même, ne désirerait plus que s’éteindre a trouvé dans le suicide assisté la parfaite métaphore de ce qu’elle désire sans se l’avouer. Il faudrait au Québec un tout autre récit pour sortir de lui-même, il devrait se redécouvrir sous une autre figure que celle d’une association de bénéficiaires malheureux et dévitalisés. La critique que Saint-Germain fait de ce qu’on appelle par habitude le modèle québécois vise plus loin, de ce point de vue, que la seule situation québécoise: on peut y voir une critique de la modernité technocratique, qui fait violence à l’homme en ne respectant pas les limites anthropologiques qui définissent justement son humanité. Saint-Germain peint ainsi une modernité qui mutile les hommes en croyant les libérer des impératifs immémoriaux et pour cela insurmontables qui structurent la nature humaine. Saint-Germain n’est pas loin de présenter le Québec comme une des sociétés occidentales les plus avancées sur le chemin de leur décomposition. Nous serions, sans le savoir, le laboratoire de la fin d’un monde. Certains applaudissent: ils appellent ça l’évolution des mentalités.
J’ai déjà eu l’occasion de l’écrire: Saint-Germain est l’écrivain indépendantiste le plus improbable du Québec actuel. Son propos n’entre dans aucune catégorie préalable et on ne saurait non plus classer son ouvrage dans la simple catégorie des essais politiques iconoclastes. Pour Saint-Germain, «le contexte social québécois n’est pas neutre: c’est un dispositif génocidaire silencieux, une aire de dressage construite par le conquérant» (p.119). C’est de la disparition tranquille d’un peuple dont nous parle Saint-Germain. «Vivant dans une sorte de français incompréhensible, de quêteux à cheval qui ont déjà brûlé leurs étendards et renié leurs lois linguistiques, toute une marmaille de bénéficiaires et d’usagers se sont pâmés devant un bichon maltais nommé Justin. Écoutant Richard Abel pis Cœur de Pirate au milieu de Pakistanais et de Tamouls lors de la fête du Canada, ils ont reçu une pointe du gros gâteau unifolié comme autant de néo-Acadiens dans un festival du homard à perpétuelle demeure, de chiens en culotte sur des chaises pliantes dans le cortège des parades. Figurants fantômes d’un documentaire portant sur leur propre disparition» (p.192). Qui, à part lui, peut parler ainsi, dans le Québec d’aujourd’hui? Le commun des mortels peinera à reconnaître sa société dans ce propos, et on le comprend, tellement il est outrancier. On devine que certains se révolteront même contre ce portrait, qui déchire d’un coup ce qu’on pourrait appeler l’image du Québec officiel.
Et pourtant, Saint-Germain, dans ses exagérations et sa tonitruance singulière, ne révèle-t-il pas une vérité inscrite dans les plis les plus intimes de notre condition collective? Et c’est la suivante: la question nationale n’est pas qu’une simple querelle gestionnaire et constitutionnelle seulement compréhensible dans les paramètres de la modernité québécoise. C’est une question de vie ou de mort pour le peuple québécois. Il s’agit de savoir si un peuple arrivé ici il y a plus de quatre cents ans et qui a fait ce pays, qui l’a fondé, pourra un jour assumer pleinement sa propre existence historique ou s’il consentira à sa régression à la manière d’une nation morte dont il ne restera que des traces folkloriques: il nous faut comprendre à quel point notre appartenance au Canada nous condamne à une inévitable disparition. Saint-Germain ne tolère pas que les leaders indépendantistes n’assument pas clairement la charge existentielle du projet qu’ils portent depuis la fondation du PQ. Il le fait brutalement, sans trop de nuances et on se gardera d’endosser sa stratégie de la table-rase qui serait politiquement suicidaire pour tout un peuple. Mais il a l’immense mérite de le dire, de ne transiger sur rien, dans une époque où chacun calcule ses petits coups. C’est rare. Et c’est précieux.