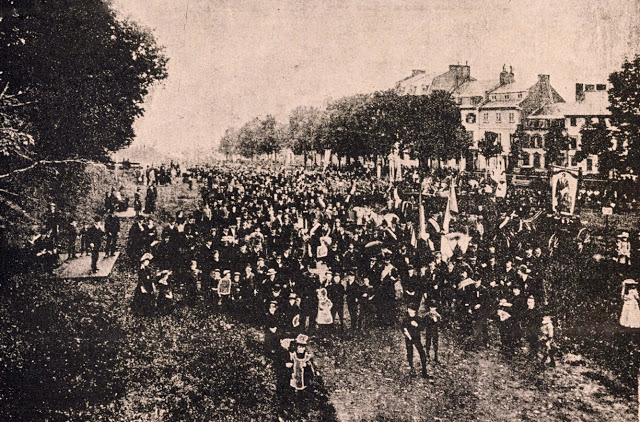Quand on connaît la haute valeur morale, intellectuelle et patriotique d'un Auguste Soulard et que l'on tombe sur un écrit de lui, on prend le temps de le lire. C'est ainsi que nous avons découvert ces derniers jours, dans un ouvrage consacré à Pierre-Martial Bardy (1797-1869), médecin et fondateur de la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec (SSJB-Q) et à qui une de nos glanures est consacrée (voyez ICI), un bref mais percutant discours que donna Auguste Soulard, alors âgé d'à peine 23 ans mais qui était déjà influent dans la vie littéraire et le mouvement nationaliste dans la Vieille Capitale, alors qu'il portait un toast durant le banquet inaugural de la SSJB-Q, le 24 juin 1842 (trois jours plus tard, il sera admis au Barreau). D'abord, abordons succinctement la vie de cet exemplaire compatriote d'antan :
Il regroupa autour de lui des jeunes compatriotes désireux de promouvoir les sciences et les lettres afin de revitaliser la patrie, et qui contribuaient aux journaux, donnant de ce fait une impulsion notable à la littérature canadienne-française qui en était alors à ses premiers balbutiements.
Admis au Barreau le 27 juin 1842 (dix ans jour pour jour avant son décès). La même année, il collabora à la fondation de la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec. À titre d'avocat, il obtint de nombreux succès dans les procès auxquels il participa. Vers 1846, son cabinet d'avocat, situé sur le quai de la Reine dans le port de Québec, devint un foyer pour les jeunes avides de culture et de progrès. Avec quelques-uns parmi eux, il forma l'équipage d'un yacht, La Belle Françoise. Il collabora à divers journaux, dont Le Canadien et Le Fantasque.
Selon l'historienne littéraire Jeanne d'Arc Lortie, Auguste Soulard « n'a pas d'œuvre d'envergure, par contre il fait montre d'un goût exquis, d'un jugement sûr, d'une critique juste et bienveillante qui en font un guide et un éveilleur d'intelligences. [...] Il mérite de survivre en tant qu'artisan discret, dynamique et résolu de la résurgence culturelle des années 1840 ». Atteint de tuberculose, Auguste Soulard est mort dans son village natal de Saint-Roch-des-Aulnaies le 27 juin 1852, âgé de 33 ans, six jours après que son père eut succombé à la même maladie. Ils reposent tous deux au sous-sol de l'église de Saint-Roch-des-Aulnaies, dont le terrain fut donné à la paroisse par le père d'Auguste Soulard.
Il n'existe pas de portrait connu révélant les traits d'Auguste Soulard, ce qui est très malheureux.
* * *
Soulard a composé un poème, Mon pays, d'une beauté et d'une puissance évocatrice telles qu'à le goûter on souhaiterait en faire l'hymne national de la nation, la nôtre, issue de Nouvelle-France. Et les témoignages de ses contemporains attestent du calibre intellectuellement et moralement supérieur de ce jeune homme qui contribua considérablement à notre renaissance culturelle et littéraire nationale, et ce, au moment même même ou un Lord Durham prétendait dans son célèbre rapport que nous n'étions qu'un «peuple sans littérature et sans histoire», qui ne saurait trouver son bonheur que dans son assimilation à la culture anglo-saxonne. De ces témoignages de ceux qui ont connu, admiré et aimé Auguste Soulard, vous aurez un aperçu via les quelques hyperliens auxquels ont peut accéder au bas de la présente glanure.
Le texte de la brève mais percutante allocution que prononça Auguste Soulard lors du banquet inaugural de la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec, le 24 juin 1842, mérite d'être sorti des oubliettes, parce qu'il nous fait mesurer à quel point le journalisme dans le Québec d'aujourd'hui se situe à des années-lumières de ce qu'il fut à ses origines et tel que Soulard y décrivait sa mission et sa raison d'être. On mesure notamment ce fossé béant entre ce que fut le journalisme d'ici et ce qu'il est devenu en songeant au spectacle peu reluisant de ces médias subventionnés par l'État et qui, comme on le constate notamment dans la situation de crise politico-sanitaire et économique que nous subissons depuis près d'un an, ne se font plus les gardiens de l'intérêt du peuple et encore moins les critiques de la gestion et des échecs lamentables des gouvernants.
Pire encore, au lieu de défendre les droits fondamentaux, les journalistes de notre époque, comme le révèle encore la présente crise sanitaire, se font les chiens policiers de l'État en traquant les réfractaires tout en aboyant à leur sujet des insultes criardes et pas très intelligentes du genre "complotistes", "covidiots", "touristatas". Et tout ceci est éructé par les journalistes et blablateux médiatisés sans égard ni considération pour la juste et nécessaire critique des mesures politiques ruineuses pour l'économie nationale qui sont imposées de manière aussi improvisée qu'incohérente par la caste politicienne au pouvoir et sa gestion désastreuse d'un système étatisé de santé qui, outre de coûter des milliards de dollars, contrôle exclusivement les hospices pour personnes âgées (ou "CHLSD", d'après l'indigeste jargon bureaucratique) où se trouvent le plus grand nombre pour ne pas dire la quasi-totalité des victimes du fléau covidien, et où nos aînés sont moins bien traités que des animaux. De fait, ce comportement quasi généralisé des professionnels des médias permet au gouvernement d'éviter l'exposition au grand jour, et avec la constance requise, de sa monstrueuse incurie dont les personnes âgées confiées à ses soins sont les principales victimes. Il y a certes dans la profession journalistique quelques voix moins serviles et davantage soucieuses d'intégrité professionnelle, mais, en plus de s'avérer d'une rareté extrême, ces voix sont surtout le fait de journalistes retraités, comme Michel Morin, qui a longtemps œuvré à Radio-Canada puis à TVA et qui fut l'un des plus remarquables et compétents journalistes d'enquête que le Québec ait connus, notamment en matière d'incurie gouvernementale dont durant des décennies il a débusqué d'innombrables méfaits. Mais on peut légitimement se demander si M. Morin pourrait jouir des mêmes audace investigatrice et liberté critique s'il était encore à l'emploi de médias qui ne survivent plus que grâce aux subventions de l'État, compte tenu de la chute drastique des revenus des entreprises médiatiques due au fait qu'une portion croissante du public, à force de subir le déferlement d'une propagande de plus en plus trompeuse et tonitruante, perd confiance dans la mascarade de journalisme qui leur est martelée 24 heures sur 24.
Si nous évoquons ici-même la présente crise sanitaire, et ce, quelles que soient nos opinions sur celle-ci (et il ne s'agit surtout pas de nier la réalité du virus), c'est parce que c'est depuis un an l'enjeu dominant dans l'espace public et médiatique. Mais cette veulerie, cette incompétence, ce parti-pris, cette médiocrité, cette corruption, pour ne pas dire cette inutilité à l'information qui caractérisent les médias d'aujourd'hui, sont devenus tels qu'on serait justifié de penser qu'ils seraient tout autant susceptibles de nuire à la couverture juste et éclairante d'autres enjeux tout aussi névralgiques pour notre société et le monde. En tout cas, écoutons ce qu'Auguste Soulard disait en 1842, et mesurons à quel point chez nous le journalisme est bel et bien mort et en état de putréfaction avancée. En fait, la célébration par Soulard du journalisme tel qu'il était en son temps, constitue un réquisitoire implacable contre la corruption et l'imposture médiatiques dont nous sommes de nos jours les témoins.
Il vaut donc la peine de faire circuler largement ce discours de Soulard afin que nos concitoyens puissent faire par eux-mêmes la comparaison entre la grandeur du journalisme d'antan et l'état de pourrissement dans lequel il se trouve de nos jours. D'ailleurs, la capacité d'établir des comparaisons de cette sorte ne constitue-t-elle pas l'une des utilités les plus essentielles de la connaissance historique ?
Discours d'Auguste Soulard
au banquet de fondation de la
Société Saint-Jean-Baptiste de Québec,
24 juin 1842
 |
Fondée le 14 juin 1842, la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec
existe encore de nos jours. Pour la contacter, cliquer sur cette image. |
Les tyrans doivent redouter la puissance de la presse ; car chaque fois que la tyrannie s'affuble des dehors de la justice pour séduire le peuple et lui ravir ses droits, la presse, sentinelle active, de sa position élevée, observe ses mouvements et dévoile ses trames.
La presse exprime les besoins du peuple, promulgue des idées fécondes, dissémine toutes les connaissances utiles ; et par la seule force de la justice et de la vérité, enchaîne les sentiments sous sa bannière. Elle enseigne aux gouvernements toute la grandeur et l'étendue de leur mission qui est le bonheur de ceux pour lesquels ils sont fondés, et leur indique les voies à suivre pour pourvoir à cette fin ; et ce qui leur est encore plus désagréable, elle signale chacune de leurs erreurs.
Les gouvernements sages et bien disposés envers le peuple accueillent ses conseils avec bienveillance, s'empressent de faire cesser les griefs qu'elle expose et d'accéder aux justes demandes qu'elle exprime. De cette union de la presse qui éclaire et du gouvernement qui agit découle le bien général, le bonheur et la prospérité d'un pays.
Mais cette puissance de la presse, dont l'influence est si salutaire, ne reçoit pas le même accueil auprès des tyrans, auprès de ces grands qui, contents du lot qui leur est échu dans le partage des avantages humains, veulent interdire aux masses tout désir d'allégement à leur maux et de perfectionnement dans la machine sociale ; enfin auprès de ceux qui trouvent dans les abus existants une pâture dont ils ne veulent pas se laisser dépouiller.
Cette voix importune de la presse qui s'élève sans cesse pour reprocher aux tyrans leurs fautes, pour enseigner au peuple ses droits imprescriptibles, pour signaler toutes les injustices, cette voix, dis-je, qu'ils devraient respecter, les transporte de rage, et ils poussent la folie jusqu'à vouloir l'étouffer. Ils peuvent bien la charger de chaînes et la reléguer dans le réduit obscur d'une prison, mais l'étouffer, jamais ! Elle reprend bientôt, en dépit des persécutions et des obstacles, un essor plus élevé qu'auparavant. De forte qu'elle était, elle devient tonnante et le peuple attentif admire son dévouement, la chérit et l'écoute comme la voix d'un martyr. La tyrannie n'a plus qu'à redouter sa puissance.
Il est inutile de parler de cette presse méprisable, inventée par le génie du mal pour préconiser toutes les infamies politiques et rendre l'hommage de la bassesse et de la servilité aux gouvernements qui se dégradent en la payant. Si j'en parlais, ce serait pour la flétrir davantage, s'il est possible ; pour démontrer les entraves qu'elle met au bonheur du peuple et déchirer pour toujours le voile infâme qu'elle étend devant la vérité. Mais je n'en dirai rien.
[…] La presse de ce pays s'est aussi acquis des droits immortels à la reconnaissance du peuple canadien, par son dévouement à sa cause, son courage à défendre ses droits envahis, ses talents à repousser la calomnie et sa constance à signaler les fautes d'une administration corrompue aux époques les plus orageuses de notre histoire. Les incarcérations de 1810, celles de 38 et 39, et les persécutions de tous genres qu'elle éprouva en ces jours de sanglante mémoire sont des titres trop puissants auprès d'un peuple sensible, pour qu'il soit permis d'insister.
Donc, le peuple, témoin de la lutte généreuse de la presse contre un pouvoir tyrannique, lui décerne à bon droit l'hommage d'une reconnaissance éternelle.
Extrait de : F.-X. Burque, Le docteur Pierre-Martial Bardy, sa vie, ses œuvres et sa mémoire, Québec, Presses de la Libre Parole, 1907, p. 38-40.