Les souverainistes québécois, depuis le dernier référendum, n’ont cessé de vouloir mettre à jour l’argumentaire indépendantiste, comme s’il fallait toujours l’accorder aux modes idéologiques. Il fallait faire la souveraineté pour approfondir le modèle québécois pour préserver la social-démocratie, pour réaliser un projet de société progressiste et même pour sauver la planète, comme si le Québec, devenu un pays, deviendrait une puissance écologiste mondiale, ce qui excitait les rêves de grandeur de militants n’acceptant plus de définir leur peuple comme une petite nation au sens kundérien. Il fallait un «nouveau discours», pour moderniser la vision du camp national, pour lui permettre de se déployer malgré la défaite et de trouver de nouveaux électeurs chez les catégories de la population qui y étaient depuis toujours réfractaires. C’était le nouveau test de légitimité qu’il devait passer.
Inversement, les arguments fondamentaux, à l’origine du combat indépendantiste, passaient de plus en plus mal et étaient désormais catégorisés comme «identitaires» et relevant d’un vieux nationalisme passé de mode, ne pouvant apparemment plus interpeller les jeunes générations. On pouvait y voir, évidemment, l’influence de ce souverainisme «progressiste» qui voulait l’indépendance, mais peinait à nommer la nation au nom de laquelle il fallait la faire et qui est devenue hégémonique suite à la fameuse déclaration de Jacques Parizeau le soir du référendum de 1995. Comment justifier l’indépendance d’un peuple dans un contexte marqué par l’obsession multiculturaliste, qui fait le procès de la légitimité même des nations occidentales et qui plaide pour la dissolution des frontières? C’était l’époque du nationalisme «civique», que l’on jouait contre un nationalisme «ethnique» fantasmé à la manière d’un épouvantail collectif – le drame étant qu’on associait à ce nationalisme «ethnique» tout ce qui relevait de l’histoire, de la culture, de la langue, de l’identité, de la démographie. Comment faire l’indépendance d’un peuple dont on censure l’identité? Le mot identitaire est même devenu péjoratif chez plusieurs.
Il faut bien convenir que ces arguments ont mal vieilli: ils ont quelque chose d’artificiel, de daté. Il s’agissait d’arguments faits pour plaire au système médiatique davantage que pour se connecter aux passions profondes qui animent la cause nationale. Les souverainistes se parlaient entre eux de colloque en colloque, mais plus personne ne les écoutait vraiment, et qui prenait la peine de les écouter avait inévitablement envie de les fuir. Entre eux, ils reconstruisaient sans cesse la définition de la nation, au nom de «l’inclusion» et de la «diversité», comme s’il s’agissait simplement d’une construction verbale, décrochée des réalités démographiques, historiques, sociologiques et culturelles. Les «grands penseurs» de l’époque étaient pénibles, répétitifs, moralisateurs, et intellectuellement stériles. Qui se risque à relire les ouvrages associés au souverainisme post-référendaire sera frappé par leur absence de vitalité. Surtout, à force de se dénationaliser, le souverainisme s’est déréalisé. Il est devenu insaisissable, vaporeux. Il s’est coupé des ressorts profonds du peuple québécois.
Avec la crise des accommodements raisonnables de 2007-2008, la question identitaire a retrouvé sa place dans le débat public, malgré le désaveu de l’intelligentsia «progressiste» qui traitait avec condescendance ceux qui la prenaient au sérieux. Avec la Charte des valeurs, notamment, le souverainisme a alors cherché à renouer avec le nationalisme de la majorité historique francophone, mais entre-temps, cette dernière ayant entrepris sa migration vers la mouvance autonomiste, d’abord l’ADQ, puis la CAQ, qui reformulaient le combat québécois dans un contexte qui n’était plus marqué par l’horizon référendaire. Le nationalisme identitaire autonomiste non souverainiste avait pris le relais du souverainisme dénationalisé, «désidentitarisé», et qui, au nom du progressisme, s’était même converti au multiculturalisme même s’il l’avait renommé interculturalisme.
Un quart de siècle après le référendum de 1995, l’espace politique nationaliste s’est complètement reconfiguré. D’un côté, la CAQ occupe l’espace du nationalisme gouvernemental, mais semble de plus en plus se contenter d’un nationalisme cosmétique et rhétorique, comme en témoigne le très décevant projet de loi 96 ainsi que son refus de baisser significativement les seuils d’immigration. De l’autre, l’existence même du PQ est compromise, les souverainistes proposant aux Québécois une excellente réponse à une question que les Québécois ne se posent plus. Il n’en demeure pas moins que la question nationale pourrait renaître et qu’un véhicule politique résolu à l’embrasser pleinement demeure absolument nécessaire dans notre vie politique. On trouve même une nouvelle génération militante qui embrasse l’indépendance, et une nouvelle génération d’intellectuels remarquables qui placent au cœur de leur réflexion la situation existentielle de la nation québécoise, en plus de tenir tête aux idéologies délirantes qui s’agrègent dans le wokisme.
Aujourd’hui, les raisons fondamentales pour faire l’indépendance reviennent avec une netteté: c’est de l’existence même de notre peuple dont il est question. C’est de sa survie qu’on parle alors que nous connaissons, pour reprendre les mots de Martin Lemay, une tempête parfaite pouvant nous conduire à notre assimilation. Il faut le dire: le peuple québécois peut mourir. Il peut disparaître. Cela ne veut pas dire qu’il faut capituler ou se décourager, mais qu’il faut situer la lutte nationale à cette hauteur pour la réanimer vraiment. Les indépendantistes ne proposent pas seulement une meilleure option pour le peuple québécois: ils doivent convaincre la population que sans l’indépendance, nous disparaîtrons et nous ne serons plus qu’un résidu ethnique et folklorique sur notre propre terre, dans le seul pays que nous ayons. Mais d’abord et avant tout, ils doivent s’en convaincre eux-mêmes, en faisant un exercice de lucidité politique et intellectuel qu’ils ont trop souvent tendance à assimiler au pessimisme. La question linguistique qui revient est animée par cette angoisse que les Québécois recommencent à ressentir, même s’ils peinent à la formuler.
La baisse de notre poids démographique dans une fédération qui fait du multiculturalisme son principe fondateur, et au Québec même, désormais, où la majorité historique francophone est symboliquement et politiquement dégagée de Montréal, qui se présente comme un territoire affranchi de la nation québécoise, annonce un effondrement national d’ici quelques décennies à peine. En fait, les Québécois francophones sont de plus en plus ouvertement détestés chez eux, comme s’ils y étaient de trop. On les méprise. Les Rhodésiens sont de retour. On oblige les Québécois à développer une conscience honteuse de leur histoire en les poussant par exemple à voir dans la Nouvelle-France une entreprise prédatrice illégitime et condamnable. On veut les obliger à se soumettre à la théorie du racisme systémique qui condamne en elle-même l’existence de la nation, quoi qu’en pensent ceux qui y adhèrent sans la comprendre. Et on juge scandaleux leur refus de se reconnaître dans cette théorie. Si un nouveau camp du Oui doit naître, c’est dans le refus résolu de cette dépossession et dans la volonté de se réenraciner dans une histoire longue qui ne prend son sens qu’à la lumière de l’indépendance et dans une résistance contre l’idéologie dominante qui pousse à la dissolution des peuples. Cela exigera un courage immense.

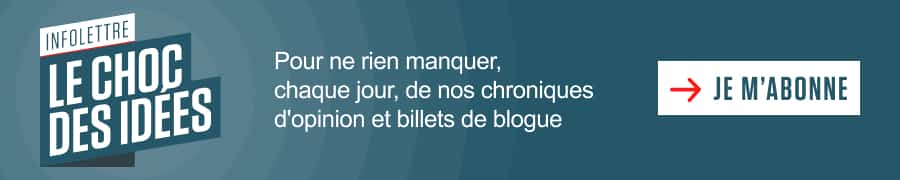





















Laissez un commentaire Votre adresse courriel ne sera pas publiée.
Veuillez vous connecter afin de laisser un commentaire.
Aucun commentaire trouvé