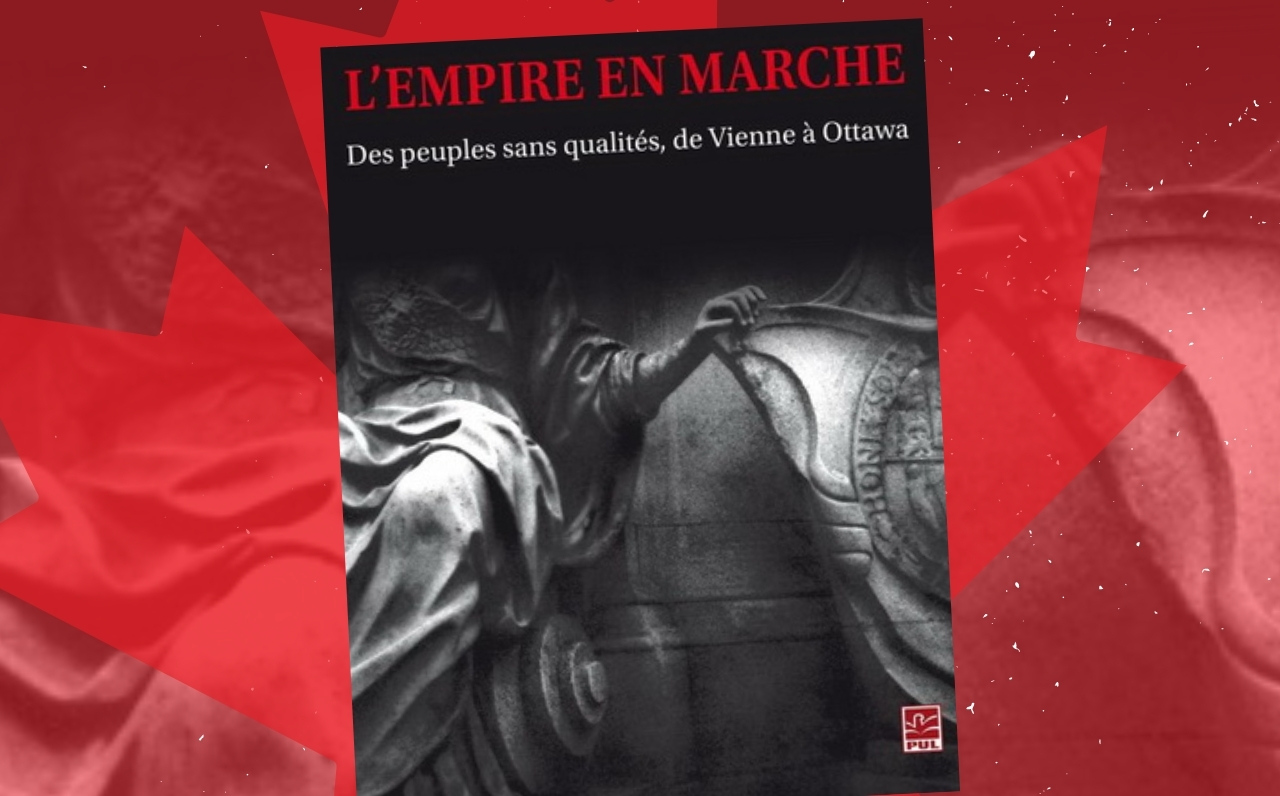Lorsque j’ai assisté au lancement de L’empire en marche du professeur Marc Chevrier de l’UQAM, juste avant la pandémie, je me suis demandé ce que la notion d’empire canadien pouvait ajouter à celle du fédéralisme bien imparfait que nous connaissons. Je me suis rendu compte à la lecture de ce livre imposant et érudit que la réponse est : beaucoup de choses. Chevrier est à la fois constitutionnaliste et politologue. Il peut, en portant ce deuxième chapeau tout en évoquant les subtilités du droit constitutionnel, faire ce que le juriste trop technique ne peut pas, c’est-à-dire démontrer les rapports de domination qui sous-tendent toute forme de fédéralisme, celui que l’on trouve au Canada en particulier. Jamais à mon sens la Constitution canadienne n’aura été aussi profondément déconstruite.
Le texte, rédigé par une plume d’exception, est savant et exigeant. Sa vaste portée et sa culture vont de la philosophie à l’histoire de l’Antiquité. L’effort de lecture donne de riches résultats.
On apprend par exemple que l’idée du fédéralisme, dont on vante les bienfaits comme facteur de civilisation, a depuis son origine été associée à la conquête, dont la plupart des théoriciens et professeurs actuels détournent pudiquement les yeux. Les Romains imposaient le foedus (un pacte assimilateur) à leurs nouveaux sujets. Certaines de leurs conquêtes devenaient des provinces.
Voici ce qu’en disait Montesquieu au 18e siècle :
« C’était une manière lente de conquérir. On vainquait un peuple, et on se contentait de l’affaiblir; on lui imposait des conditions qui le minaient insensiblement; s’il se relevait, on l’abaissait encore davantage; et il devenait sujet, sans qu’on pût donner une époque de sa sujétion. » (p.203)
L’essence du fédéralisme est une conquête lente et continue qui relève de l’art de la gouvernance des empires, qu’il soit romain, britannique ou canadien, jusqu’à l’absorption totale du peuple conquis, qu’il soit québécois ou autochtone. Cette absorption est la raison d’être et le cœur du projet constitutionnel canadien.
Voici ce qu’en écrit Chevrier :
« Ainsi, placés dans une situation de domination formalisée par un traité ou une constitution qui leur enlève la souveraineté en échange d’une liberté bornée à certains domaines de l’action collective, ces peuples fédérés s’épuiseraient insensiblement, au point à la longue de voir leur intégration plus poussée à la culture et au pouvoir dominants comme une fatalité, une nécessité, voire un grand bien ou une délivrance. S’il arrivait que, malgré les entraves mises à leur épanouissement, ils se renforcent, se cabrent, menacent la cohésion de l’ensemble, le pouvoir confédéral userait alors de moyens constitutionnels ou autres pour les affaiblir et même leur faire regretter les hardiesses de leur songe de liberté. » (p. 204)
Pour Chevrier, le fédéralisme est nécessairement dominateur puisqu’il est l’expression même de la domination. Il est très loin de ceux qui s’opposent au pouvoir de dépenser ou à une quelconque intransigeance fédérale au nom d’un fédéralisme idéalisé dont Ottawa se serait éloigné. Le fantasme des deux peuples fondateurs a servi pendant plusieurs générations à occulter la réalité; il ne servait qu’à consoler les conquis pendant que la nation dominante s’employait depuis toujours à réduire leur poids démographique, tout en pratiquant un génocide culturel et parfois physique envers les Autochtones.
Dès le départ, l’Acte de Québec de 1774 a revêtu la Conquête d’habits romains (p. 343) en accordant des concessions limitées sur la religion et sur le droit civil français (implicitement sur la langue), à une collectivité qu’on ne pouvait assimiler rapidement ou déporter massivement comme les Acadiens. Pour Chevrier, ce ne fut là que le simple reflet d’un rapport de force temporaire et déclinant. La solution durable qui permet d’affaiblir ce rapport de force est le fédéralisme, comme le préconisait lord Durham dans son fameux rapport après le soulèvement des Patriotes. Pour Durham, le fédéralisme instaure un mécanisme subtil de dissolution des nations captives (p. 417). On a tort de croire que l’Acte d’Union de 1840 a mis en œuvre ses idées complètement. Ce n’était que le premier pas. Son rapport recommandait le fédéralisme de toutes les colonies britanniques en Amérique du Nord. L’union avec la seule Ontario donnait beaucoup trop de pouvoir aux futurs Québécois parce qu’ils étaient des gouvernants associés, à égalité avec les Ontariens. L’aboutissement de la pensée de Durham est la Constitution de 1867. Pierre Elliott Trudeau en a été le fidèle continuateur en y ajoutant la couche du multiculturalisme, et en rompant définitivement avec la nécessité d’obtenir le consentement du Québec pour modifier la Constitution.
La fédération est un empire intérieur (p. 326). Le Canada est fondé sur des conquêtes successives, grandes et petites, qui se perpétuent (la pendaison de Louis Riel, l’assimilation des francophones hors-Québec, les pensionnats autochtones) (p. 349-350). L’empire est un principe structurant du Canada (p. 454-455). Pour être plus efficace, l’empire canadien demeure innommé et n’ose pas s’avouer (p. 501), mais les pères de la Confédération, réunis dans une constituante de 1864 à 1866 dans le sillage de la guerre de Sécession, voulaient entre eux explicitement créer un nouvel empire pour rivaliser avec celui des États-Unis qui paraissait en voie d’éclatement (p. 443-444). Dans un empire, le droit ratifie un rapport de domination (p. 465): c’est ce que font les tribunaux chaque jour et de nombreux juristes qui considèrent que ce rapport va de soi. Le multiculturalisme justifie l’immigration comme fondement de l’empire (p. 579).
Le concept d’union est plus important dans la Constitution canadienne de 1867 que le fédéralisme. Dans la version française officieuse, le fédéralisme n’est mentionné qu’une fois par un adjectif, une union fédérale. Dans la version anglaise qui est la seule à avoir une valeur juridique, le fédéralisme est un adverbe, federally united, là encore à une seule occasion. Chevrier souligne que les États qui se disent des Unions sont tous des empires ou des empires en gestation (United Kingdom, United States, Union européenne) dont la raison d’être est l’absorption de différents peuples sur une période pouvant s’étendre sur plusieurs siècles. La Déclaration d’indépendance américaine est la plus transparente : elle affirme que son but est a more perfect union, ce qui exprime une dynamique de centralisation. Plusieurs auteurs ont relevé que cette dynamique existe dans toutes les fédérations même si les termes employés sont propres à chacune (p. 299 à 301). Une constante, toutefois : le pouvoir de dépenser du gouvernement fédéral, qui est un moyen privilégié de cette centralisation qu’on cherche vainement à neutraliser ou même à encadrer.
Au Canada, l’empire s’est consolidé depuis 1982 avec l’idéologie des droits de l’homme destiné à combattre un nationalisme québécois considéré rétrograde; c’est une forme de religion civile, qui comme toutes les idéologies se prête mal à un débat rationnel. Rappelons que dans le débat sur la reconnaissance d’une société distincte au Québec, des féministes ontariennes s’opposaient à l’Accord du lac Meech pour le motif qu’il fallait protéger les femmes du Québec enfermées dans une société attardée, et ce même si des féministes québécoises exprimaient leur désaccord avec elles. Ce dialogue de sourds exprime, par la voix nouvelle de groupes de pression qui ont une audience constitutionnelle, l’éternel rapport de domination canadien. L’empire canadien s’est consolidé sur une idéologie qui rivalise avec la religion (p. 616). L’union canadienne est un processus continu d’intégration (p. 461).
Le Canada et le Royaume-Uni sont des unions qui reposent sur des conquêtes (p. 461); il en est de même des États-Unis, qui ont été créés sur des conquêtes intérieures aux dépens des nations autochtones. On peut ajouter que l’expression symbolique de la domination continue, dans les deux premiers cas, est la monarchie.
Les conquêtes se situent hors du droit et en sont la source (p. 466). Leur effet est reconnu par le principe d’effectivité du droit international, que les constitutionnalistes méconnaissent généralement, alors que les philosophes politiques depuis Rousseau ont fondé l’État sur un contrat social entièrement fictif. Ses prédécesseurs tels que Hobbes, Hume et Montesquieu étaient plus réalistes (p. 354 à 359). Citant l’Écossais David Hume, Chevrier écrit :
« S’il est souhaitable que le consentement institue l’autorité politique, il demeure, objecte Hume, qu’on ne trouve nulle trace dans l’histoire d’un quelconque « contrat originel » qui ait fondé un État et qui ait obligé par la suite les descendants des contractants fondateurs. (…) Il ajoute : « la conquête ou l’usurpation---c’est-à-dire, en des termes simples, la force---par la dissolution des anciens États, est à l’origine de presque tous ceux qu’on a vraiment établis dans le monde. » (p. 355)
Hume écrivait avant les révolutions américaine et française. Les Américains diront que leur Constitution de 1787, dont ils sont si fiers, a concrétisé le contrat social imaginé par Rousseau à la même époque. C’est oublier qu’il a été imposé par la force non seulement aux Britanniques, mais aussi aux monarchistes parmi les colons américains qui composaient le tiers de la population (dont plusieurs ont rejoint le Canada), aux Noirs asservis et aux Autochtones victimes d’un génocide très réel. Quant aux Français, la Déclaration des droits de l’homme de 1789 n’efface pas la Terreur de Robespierre dont il a fini victime guillotinée, ni les massacres des Vendéens ou les noyades de masse des royalistes d’autres régions. La force fut dans l’un et l’autre cas déterminante. Ces révolutions ont en commun l’abolition de la monarchie par le sang, même si George III a sombré dans la folie et n’a pas été décapité comme Louis XVI. Les constitutionnalistes se penchent sur les textes officiels écrits par les vainqueurs et laissent discrètement aux historiens le rappel de ces événements.
Chevrier considère que la lente marche du Canada vers l’indépendance a caché sa propre mutation en empire. Cette marche s’est accompagnée de ce que Nietzsche appelle la spiritualisation de l’hostilité dont Trudeau père et fils furent les héritiers :
« On serait tenté de dire, d’après l’exemple canadien, que tout empire naît par la force, mais s’accroît par la spiritualisation de l’hostilité qu’il parvient à entretenir sans la laisser trop s’emballer. » (p. 386)
Cette hostilité politique permanente à l’égard du fait national québécois est inscrite dans l’ADN du Canada parce que le Québec est une menace potentielle à son existence.
L’auteur reconnaît que le Canada et l’Union européenne, tout comme le Royaume-Uni de Boris Johnson qui est nostalgique d’un passé glorieux, sont des empires intermédiaires à l’intérieur du méga-empire américain (p. 622). Les États-Unis sont aussi une fédération et le Royaume-Uni est historiquement une quasi-fédération composée de trois nations dominées par une quatrième. Chevrier conclut par cette phrase qui résume sa pensée : « Le fédéralisme s’avère le cache-sexe de l’empire. » (p. 634).
Si nous n’avons pas un sursaut de dignité collective dans la présente décennie, le peuple québécois sera probablement appelé à disparaître d’ici la fin du siècle. Après 2030, si nous demeurons passifs et inconscients en nous inclinant devant la déraison populiste et la consternante médiocrité des gouvernants de notre temps, les tendances lourdes de l’immigration et le combat idéologique du multiculturalisme canadien auront raison de notre culture, dont notre identité politique est une expression. Le fédéralisme canadien aura alors atteint son but originel. Les quelques irréductibles qui resteront pour un temps pourront au moins comprendre en lisant Chevrier pourquoi il en aura été ainsi.
Ceux qui voyaient clair étaient les militants autochtones, lors de la crise ferroviaire du début de 2020, qui brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire : « Pour un monde sans Kanada », avec un K. Aucun militant indépendantiste n’a jamais encore osé en faire autant. C’est le seul espoir subliminal que laisse Chevrier en comparant constamment le Canada au cours de son ouvrage, depuis le sous-titre jusqu’à sa dernière page, au défunt et non regretté empire austro-hongrois, qui a été balayé de l’histoire après la première guerre mondiale devant son incapacité à absorber ses composantes nationales. L’année 1867 a d’ailleurs aussi été celle d’un dernier soubresaut constitutionnel de cet empire voué à l’échec et à la disparition. On s’accroche aux espoirs et aux rêves que l’on peut trouver.
L’ouvrage de Chevrier est aussi, malgré quelques bémols (le titre opaque et peu accrocheur, la lecture difficilement accessible hors des cercles d’intellectuels malgré la brillance du style, l’étonnante absence qu’on peut reprocher à l’éditeur d’un index et d’une bibliographie qui auraient été utiles au chercheur, quelques pages peu nombreuses qui sont moins convaincantes), une réplique magistrale à celui, récent, de Peter Russell, un influent politologue de l’Université de Toronto, portant sur les conquêtes inachevées du Canada, qui entretient le mythe du compromis plutôt que l’explication beaucoup plus persuasive de l’hostilité larvée et mal contenue.
Un pays fondé sur le mensonge, l’hypocrisie, l’illusion et le racisme ne mérite pas d’exister. La spiritualisation négative ou sublimation de l’hostilité canadienne repose toujours finalement sur le vieil adage, la fin justifie les moyens, qui est dans les grands moments, quand on met les convenances de côté pour arriver au fond des choses, la véritable éthique de la Constitution de ce pays imposé et l’héritage moral de sa refondation en 1982. Seule une vision positive, improbable mais possible, encore trop peu articulée, de l’indépendance et de la république québécoises pourra la surmonter.
L’EMPIRE EN MARCHE : Des peuples sans qualités de Vienne à Ottawa
Auteur : Marc Chevrier
Presses de l’Université Laval, 2019, 635 p.