Entre mythe et réalité, l'univers de Gaétan Soucy déconcerte, mais ravit l'amoureux de la littérature. Cette fois, dans La petite fille qui aimait trop les allumettes, il imagine un choc des cultures, la rencontre entre des êtres coupés de toute civilisation, nourris d'archaïsme, et la civilisation moderne, centrée sur l'individu.
Comment décrire l'indescriptible? À propos de ses livres, Gaétan Soucy affirmait lui-même l'an dernier qu'il sentait son propos très « déficitaire » en comparaison avec le contenu du volume. De ce troisième roman tout juste arrivé sur nos tablettes — La petite file qui aimait trop les allumettes —, il ne pense pas moins. «Ce que j'avais à dire sur la chose, c'est écrit là, dans le livre.»
Même s'il s'y prête de bonne grâce, avouons que l'entrevue ne figure pas très haut au rang des activités dites agréables. Le plaisir véritable tient en trois petites semaines d'intense activité d'écriture, où une idée déjà un peu travaillée dans le passé l'obnubile, conduit sa main, occupe entièrement sa pensée, et mène à ces dizaines de pages.
En toute fin du volume, c'est bien inscrit : « 27 janvier - 24 février 1998 ». Trois toutes petites semaines d'écriture d'une intensité sans doute rare, et qu'on voudrait d'une quelque manière similaire à l'état dans lequel le destinataire du livre est plongé. Difficile en effet de trouver les mots justes pour donner un aperçu, si mince fût-il de cette littérature conjuguée sur un mode unique, véritable bouffée d'air frais dans un univers littéraire trop souvent uniforme.
Racontons : l'histoire de deux jeunes adolescents, dont nous tairons le sexe — roman oblige —, élevés par un père visiblement dérangé dans un monde archaïque, mais surtout entièrement coupé de la société.
Étrangers à toute notion de civilisation, autre que celles auxquelles ils ont accès grâce aux livres — ou l'enseignement prodigué par un paternel aux pratiques masochistes et religieuses anciennes, les jeunots fonctionnent avec les outils qu'on leur a fournis et sont stupéfaits lorsque le père leur fait faux bond, nouant sa vie au bout d'une corde et laissant les deux enfants en plan.
Porté par le langage
À ce contexte déjà particulier, et pour s'imprégner de l'atmosphère d'étrangeté créée par ce roman, il faut ajouter le langage forgé de toutes pièces et imposé par la nature du décor romanesque. Essayant de déterminer ce qu'il valait mieux faire avec ce cadavre encombrant, le plus déluré des deux « frères » décide d'aller au village acheter une « boîte à trou » et s'en convainc de la façon suivante : « [...] on ne pouvait pas laisser à elle-même la dépouille et s'en aller main dans la main mon frère et moi en sifflotant de l'autre côté de la pinède. Ensuite, il fallait bien mettre papa dans un cercueil convenable et pour ce faire qu'un de nous deux se sacrifie et se précipite au village pour y monnayer une boîte à trou. »
Une fois au village, réfléchissant sur les procédures mortuaires de ses « semblables » villageois, il poursuit : « J'apprenais récemment dans un dictionnaire qu'on doit poser des fleurs sur les pierres par-dessus les trous où on a enfoncé nos disparus, parce que ça leur prouve hors de tout doute qu'on ne les a pas mis dans le trou pour le plaisir, et qu'on pense encore à eux en se disant qu'on préférerait à tout prendre qu'ils soient encore là, et j’aime tellement les fleurs qu'on ne m'a jamais offertes, comme dans les plus belles histoires que je connaisse, quel je me mettrais de moi-même dans un trou si ça pouvait donner l'idée à mon frère de m'en apporter en, se disant qu'il préférerait à tout prendre m'avoir encore avec lui, mais pensez-vous. » Vous voyez le genre ?
Chaque jour, l'un des deux frères enfile la peau du « secrétarien » et transcrit dans le « grimoire » les affres de la journée. Régentés par un père qu'on imagine autoritaire en plus d'être fou, toujours à l'affût d'un « horion » qui pourrait faire voir des étoiles, les deux larrons passent de la « cuisine de notre séjour terrestre « au hangar à bois où se terre le » Juste Châtiment »,une réalité qui fascine et fait craindre à la fois et sous laquelle se cache une portion de l'incroyable dénouement de cette histoire.
Mythe ou réalité ?
L'entrée au village d'un être qui a toujours vécu reclus, au-delà de cette pinède qui trace la frontière entre la civilisation et le mode de vie archaïque d'une famille à trois têtes — c'est du moins ce que l'on croit —, ne pouvait pas passer inaperçue. Et ne pouvait pas non plus se produire sans que le cours des choses soit modifié et la suite des événements influencée par le choc des cultures. Caché dans le hangar à bois, à la suite de sa brève, mais troublante incursion au village, le personnage narrateur (la nature du roman nous impose de demeurer vague sur son identité) reproduit dans son précieux grimoire — que nous parcourons en lisant le livre - le récit de ces événements extraordinaires qui lui permettent de mettre des mots sur des notions qui jusque-là lui avaient échappé.
«Il ne faut pas faire une lecture trop étroitement réaliste du personnage, explique Gaétan Soucy. On est dans le mythe. On pourrait dire que la donnée de départ est fort improbable et il est certain que je n'ai pas voulu développer en romancier psychologique et réaliste le thème de l'adolescent qui n'aurait pas connu du tout le reste de l'univers autrement que par des ouvrages savants d'autres siècles. Ce n'est pas ce que j'ai fait.»
Comme le personnage narrateur qui s'accroche à un semblant de normalité en transcrivant fidèlement dans son grimoire les aléas de son quotidien bizarroïde, Gaétan Soucy affirme écrire pour échapper à la mort. «Je suis un fou qui croit que faire une oeuvre littéraire, ça va le sauver. Et comme c'est une folie qui est lucide, alors il y a des moments où tu réalises bien la vanité de ça. En ces moments-là, je suis plutôt maussade», affirme l'auteur, qui n'a pas 40 ans. «Si je n'écrivais pas, ce serait beau que je meure d'un seul coup. Mais le problème est justement là : je ne mourrais pas comme ça. L'image la plus forte de ce que je veux par là exprimer, je l'ai écrite dans L'Acquittement, lorsque le narrateur dit que, pour lui, la perspective de ne plus créer correspond à l'idée de se réveiller enfermé dans un cercueil, inhumé par erreur. C'est exactement comme cela que je vois cela.»
Voilà trois romans qu'il écrit, et autant de paroles et de types de langage utilisés pour rendre justice à l'histoire. «Un lecteur attentif verra que je compose toujours autour des mêmes thèmes, celui du pardon, de la faute, des obsessions aussi.» Dans La petite fille qui aimait trop les allumettes, la faute est incendiaire, et le châtiment d'une cruauté sans nom.
Avec l'écriture, Gaétan Soucy trouve son bonheur, une exaltation créatrice difficile à définir, mais aux allures salvatrices. Après l'écriture, c'est l'impression très forte d'avoir écrit «un vrai livre » qui prévaut, suivie d'une grisaille commandée par le sentiment du «à quoi bon tout ça?» «Il y a toujours cette impression mixte quel le livre est la chose la plus importante du monde, mais la plus vaine aussi. "Balancé entre le " post-partum» de la création, l'impression d'avoir tout dit, et puis le retour de la fibre créatrice Gaétan Soucy revient invariablement au pupitre, pour une autre saison de bonheur. «Je crois que je suis porté par une conviction plus grande que moi-même. C'est pour ça que je dis que je suis un fou, quelqu'un qui se trompe sûrement. Mais je ne connais pas plus belle erreur.»
LA PETITE FILLE QUI AIMAIT TROP LES ALLUMETTES
Gaétan Soucy
Boréal, Montréal, 1998, 180 pages.
L'écrivain québécois Gaétan Soucy a été emporté par une crise cardiaque à l'âge de 54 ans, ont annoncé mercredi les Éditions du Boréal.
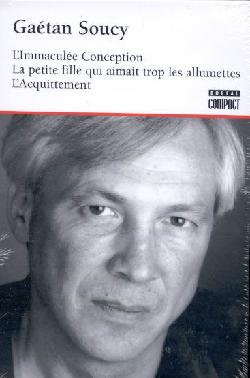

























Laissez un commentaire Votre adresse courriel ne sera pas publiée.
Veuillez vous connecter afin de laisser un commentaire.
Aucun commentaire trouvé