À peine a-t-il glissé des mains des deux commissaires que le rapport Bouchard-Taylor suscite déjà moult critiques: vilipendé par les uns pour sa langue de bois, tourné en dérision par les autres, qui y débusquent déjà le spectre du multiculturalisme, le rapport de cette commission, s'il est voué à orner les tablettes d'un bureau gouvernemental, aura à tout le moins relancé pour un temps un débat animé.
Parmi les critiques déjà formulées par les souverainistes à l'égard des conclusions du rapport, nous retrouvons certains arguments récurrents, dont le contournement des enjeux liés à la souveraineté qu'il opère et, par conséquent, l'occultation du statut de majorité des Canadiens francophones au Québec.
Il s'agit là, pour l'essentiel, des mêmes craintes exprimées par rapport à la politique du multiculturalisme, mise en place au Canada en 1971 et suivie, en 1988, de la Loi sur le multiculturalisme canadien. Mais la politique d'intégration canadienne est-elle au fond si différente de son pendant québécois?
Les deux politiques d'intégration, l'interculturalisme et le multiculturalisme, que l'on retrouve respectivement au Québec et au Canada, sont souvent et peut-être à tort perçues comme antagonistes. En effet, si le multiculturalisme canadien met l'accent sur la reconnaissance positive de la diversité culturelle et religieuse, il ne légitime pas pour autant d'un point de vue juridique et politique les communautarismes de toutes sortes.
Adossé à la Charte des droits et libertés, le multiculturalisme constitue plutôt une garantie des libertés individuelles (dont celles de conscience et de religion) qu'il protège d'ailleurs des risques de pression communautaire de la part du groupe d'appartenance ou de la majorité. La politique canadienne repose donc sur la prémisse des penseurs de la «reconnaissance» (Taylor, Kymlicka, Honneth, Renaut, etc.), selon laquelle tout individu puise son identité dans un cadre de références culturelles qu'il importe de prendre en compte dans l'espace public. La crainte du communautarisme, souvent perçue comme une virtualité du multiculturalisme, ne semble donc pas avoir de prise réelle sous cet éclairage.
De même, l'interculturalisme québécois préconise un respect du pluralisme des valeurs. Dans les fondements normatifs du «contrat moral» (1990), qui fixe les règles du jeu entre les immigrants et la société québécoise, on retrouve certes l'exigence d'apprendre le français, qui représente l'un des principaux vecteurs d'intégration, mais on reconnaît en même temps le pluralisme constitutif de la société québécoise. En ce sens, la politique québécoise, qui ne définit plus l'intégration en termes de «convergence culturelle» (1978), ne s'écarte pas autant qu'on peut le penser des principes de fond du multiculturalisme.
La démocratie, dans ses principes fondamentaux, implique un respect des visions du monde concurrentes, ne serait-ce que par l'intermédiaire des partis politiques différents qui s'affrontent dans la course au pouvoir. Son socle de valeurs est donc précisément celui qui permet au pluralisme des valeurs de s'actualiser dans l'espace public.
Même si l'idée d'une nationalité fondée sur une appartenance ancestrale commune (canadienne française) est séduisante en ce qu'elle permet à un peuple uni par les mêmes référents culturels de fonder des convictions collectives fortes, elle pose certains obstacles en contexte démocratique. Notamment parce qu'elle implique d'adhérer à des valeurs substantielles ou culturelles définies dans la matrice de l'idéal souverainiste.
Or, l'adhésion à ce projet politique ne fait pas forcément l'unanimité et comporte par définition une protection prépondérante des droits collectifs de la majorité par rapport aux droits individuels, y compris en ce qui touche aux symboles religieux, comme si ces derniers indiquaient, pour certains, l'appartenance à un ensemble de valeurs en concurrence avec celles de la citoyenneté. Dans cette mesure, les valeurs nationales fortes risquent de subsumer une volonté subtile d'assimilation, qui bien entendu ne peut légitimement fonder le projet démocratique.
Mais cela ne veut pas dire que le nationalisme débouche nécessairement sur un tel résultat et qu'il n'y a rien qui puisse nous unir. Dans le cadre d'un nationalisme civique, l'exigence d'apprendre le français, défini comme un vecteur d'intégration, apparaît tout à fait conforme aux principes démocratiques, à condition qu'elle ne devienne pas la condition expresse pour accéder à la citoyenneté. D'ailleurs, à cet égard, le Québec n'a-t-il pas adopté la loi 101 et ne contrôle-t-il pas déjà son immigration en veillant à ce que la connaissance du français figure parmi les premiers critères de sélection?
Enfin, il semble qu'il soit temps de braquer les projecteurs du débat actuel sur autre chose que les seuls enjeux de l'identité nationale pour aborder les véritables paramètres de l'intégration des nouveaux arrivants et de certaines minorités culturelles dans la société québécoise, dont la reconnaissance des qualifications professionnelles et l'accès au marché du travail.
***
Stéphanie Tremblay, Étudiante à la maîtrise en sociologie à l'UQAM








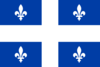







Laissez un commentaire Votre adresse courriel ne sera pas publiée.
Veuillez vous connecter afin de laisser un commentaire.
Aucun commentaire trouvé