Le traité de Paris est signé le 10 février 1763. Mettant fin à la guerre de Sept Ans, il cède le Canada et les Canadiens à George III roi d’Angleterre.
La transaction soulève toutefois d’importantes questions de droit qui, d’ailleurs, se posent encore aujourd’hui. Le droit constitutionnel français de l’époque autorise-t-il le roi de France à céder un territoire qu’il possède à titre d’usufruit, et non pas comme bien propre et patrimonial ? Plus encore, le droit l’autorise-t-il à trafiquer ses propres sujets comme s’il s’agissait d’une opération commerciale où l’on peut acheter, vendre ou céder des biens ou du bétail ?1 Quelqu’un a-t-il jamais prétendu que le roi de France avait la propriété de ses sujets ? Alors examinons la question d’un peu plus près.
Le droit international coutumier
Dans les années 1520, Francisco de Vitoria, un théologien et juriste de l’École de Salamanque, enseigne déjà que « la liberté des peuples est fondée sur la liberté naturelle de l’homme ». Il ajoute que cette liberté naturelle de l’homme et des peuples est « au-dessus de la puissance publique ». De plus, il ne reconnaît que deux titres de domination coloniale, soit « le libre consentement des peuples concernés, ou une juste guerre et juste conquête pour cause de violation du droit d’autrui ». Toutefois, selon lui, nulle part la loi ne permet qu’un souverain puisse agrandir son empire par une guerre de conquête. Bien au contraire. Un tel procédé est à ce point illégal « qu’il est considéré trop évident pour être prouvé ».2
Au siècle suivant, un juriste du nom de Hugues de Groote rédige un volumineux traité portant sur le droit de la guerre et de la paix. Au chapitre XX du livre III où il est question des conventions qui mettent fin à la guerre, il traite des pouvoirs que possèdent les rois pour conclure des traités. Concernant les sujets que l’on peut régler par traité, il écrit :
Voions maintenant fur quelles chofes on peut traiter en faifant la Paix. Les Rois qui ne poffédent pas la Souveraineté comme bien propre & patrimonial, mais à titre d’ufufruit, ne peuvent aliéner par Traité, ni la Souveraineté entiére, ni aucune de fes parties.
La Souveraineté entiére ne fauroit donc être validement aliénée fans un confentement de tout le Peuple, ou des Députez de chaque Province, qui le réprefentent & qui forment ce qu’on appelle les Etats du Roiaume.
Mais quand il s’agit de l’aliénation de quelque Partie du Roiaume, il faut un double confentement, favoir, celui de tout le Corps du Peuple, & celui de la Province ou de la Ville que l’on veut aliéner, laquelle ne peut être détachée malgré soi du Corps avec lequel elle étoit unie.3
Le droit est clair. Un roi ne peut aliéner que ce qui lui appartient comme « bien propre & patrimonial ». Mais à titre d’usufruitier, il n’a aucune compétence pour agir de sa seule autorité. Ce pouvoir n’appartient qu’à la population concernée, laquelle peut se prononcer par l’entremise de ses députés qui siègent au sein des États Généraux du royaume. Tel est l’état du droit international coutumier en février 1763. Mais il y a plus. Il y a les « lois fondamentales » du Royaume de France. Ces lois, qui ont un statut constitutionnel, sont d’application stricte et ne peuvent être modifiées que du consentement des États généraux. En matière de traité, le roi est donc tenu de s’y conformer. S’il y déroge, sa signature est tenue pour nulle et de nul effet.
Les lois fondamentales du royaume de France
Dans la France de l’Ancien régime, le roi est lié à ses sujets par un contrat de fief. Le principe à la base de ce lien vient de la féodalité qui ne reconnaît d’autre forme d’engagement qu’un contrat de fief librement consenti de part et d’autre. La foi personnelle de chacun constitue donc la matière première de l’organisation politique. En conséquence, on ne peut concevoir qu’un homme puisse être obligé envers un autre s’il ne s’est d’abord engagé en ce sens.4 Par la suite, des légistes, tant canonistes que romanistes, ont joué d’influence afin de faire glisser le concept d’engagement personnel et bilatéral vers celui d’un engagement collectif.5 L’idée de contrat reste toutefois intacte. Au contrat personnel entre le suzerain et son vassal se substitue un contrat collectif entre le roi et ses sujets. Mais le droit féodal n’a jamais reconnu qu’une rupture unilatérale puisse y mettre un terme. À la manière du droit civil, le droit féodal ne reconnaissait qu’un concours des volontés pour y mettre fin. Ceci valant d’ailleurs tout autant pour le roi que pour ses sujets ! De cette conception bilatérale de l’engagement était apparue au XIIIe siècle l’usage de consulter ses sujets lorsqu’un prince entendait aliéner ou céder un fief ou territoire de sa juridiction. Cette doctrine avait toujours force de loi lors de la conclusion du traité de Paris en 1763. Bref, les lois fondamentales du royaume de France interdisaient à Louis XV de contracter avec un souverain étranger de sa seule autorité.
Des promesses formelles et renouvelées
En France, la doctrine de la consultation populaire, empruntée au droit naturel, a donc été incorporée à la constitution coutumière du royaume. Pour ce qui est de son application à la Nouvelle-France, il faut se référer aux promesses explicites faites par Sa Majesté à ses sujets tentés par la grande aventure au Canada. Ainsi, en 1627, le Conseil d’État, présidé par Richelieu, faisait adopter l’ordonnance suivante :
XVII. Ordonnera Sa Majesté que les descendants de François qui s’habitueront au dit pays […] seront censés et réputés naturels françois, et comme tels pourront venir habiter en France quand bon leur semblera, et y acquérir, tester, succéder et accepter donations et légats, tout ainsi que les vrais régnicoles et originaires françois, sans être tenus de prendre aucunes lettres de déclaration ni de naturalité.6
Une quarantaine d’années plus tard, à l’époque de l’Édit de création du Conseil souverain de la Nouvelle-France, Louis XIV faisait adopter une deuxième ordonnance au même effet :
XXXIV. Et pour favoriser d’autant plus les habitants des dits concédés, et porter nos sujets à s’y habituer, nous voulons que ceux qui passeront dans les dits pays jouissent des mêmes libertés et franchises que s’ils étaient demeurant en ce royaume, et que ceux qui naîtront d’eux et des sauvages convertis à la foi catholique, apostolique et romaine soient censés et réputés être régnicoles et naturels françois, et comme tels, capables de toutes successions, dons, legs, et autres dispositions, sans être obligés d’obtenir aucunes lettres de naturalité […].7
Ces ordonnances confirment donc de façon explicite la volonté de garantir le lien contractuel entre Sa Majesté et ses sujets du Canada. Elles garantissent que les Français et leurs descendants seront toujours réputés naturels français sans avoir à requérir aucunes lettres de naturalité. Avec des droits aussi clairement garantis, comment Sa Majesté pouvait-elle reculer, renier sa parole, tenir pour caducs les droits de « vrais régnicoles et naturels francois » des Canadiens et, surtout, les livrer sans défense au roi le plus belliqueux et le plus impérialiste du monde. Selon la doctrine de la consultation populaire citée plus haut, Sa Majesté ne pouvait rompre le contrat bilatéral la liant aux Canadiens sans avoir obtenu leur consentement.
Des précédents tirés de l’histoire de France
Il existe de nombreux exemples, tirés de l’histoire politique, qui témoignent de la vigueur de ce procédé. En 1251, lors du passage de la ville de Marseille sous la juridiction des comtes de Toulouse, la population a été appelée à s’exprimer par voie de consultation. En 1285, lorsque le roi Philippe Le Bel a voulu céder la population de Pamiers à Roger Bernard, comte de Foix, la population a été appelée à y consentir par voie de consultation. Et lorsque ce même roi, Philippe Le Bel, voulut céder la Bretagne au roi d’Angleterre, mais sans consulter les principaux intéressés, toute la noblesse du pays s’insurgea à la suite d’Artus de Bretagne, alléguant que le roi outrepassait ses prérogatives, qu’il n’était pas de son droit de les céder sans leur consentement.8 Après le traité de Brétigny, conclu en octobre 1360, les vassaux du Languedoc, du Rouergue, de la Saintonge, du Périgord, d’Armagnac et de plusieurs autres provinces protestèrent vivement contre ces cessions unilatérales, alléguant :
Combien que le roi les quitta de foi et d’hommage… disaient les aucuns qu’il n’appartenait point à luy à quitter et que par droict il ne le pouvait faire.9
Au milieu du XIVe siècle, lorsque le Dauphiné fut réuni à la couronne de France, une assemblée de prélats, seigneurs et notables avait été convoquée afin d’obtenir leur consentement. Lorsque le roi d’Angleterre, Henry V, réclama en 1419 la cession du duché de Guyenne, le Dauphin opposa « son inhabileté » à y donner suite sans le consentement de la population concernée.10 Une fois conclu le traité de Madrid – qui avait pour objet la cession du Duché de Bourgogne à Charles-Quint – les États généraux de Bourgogne adressèrent une remontrance à François Ier pour lui signifier qu’il n’était pas en son pouvoir de préjudicier à ses sujets et vassaux en les mettant hors de l’obéissance accoutumée de France.11 C’est ainsi que, le 20 décembre 1526, après consultation d’une assemblée de notables, le Parlement de Paris cassa ce traité, le jugeant contraire aux lois fondamentales du royaume. La guerre reprit avec Charles-Quint, mais un principe de droit français avait été confirmé et porté à la connaissance de la communauté internationale. Principe qui, d’ailleurs, n’était pas unique au royaume de France. Il était à ce point répandu qu’il était assimilé à une règle de droit international. Ainsi, en 1868, le professeur Johann Gaspar Bluntschli, dans un projet de Droit international codifié, l’avait synthétisé sous l’article 286 :
Pour qu’une cession de territoire soit valable, il faut d’abord qu’elle soit déclarée telle par les habitants du territoire cédé qui sont en possession de leurs droits politiques. Cette reconnaissance ne peut, dans quelques circonstances que ce soit, être passée sous silence ni supprimée, car les populations ne sont pas une chose sans droits et sans volonté dont on puisse transmettre la propriété au premier venu.12
Le professeur Bluntschli avait brillamment exprimé que, de la réification civique ou politique des êtres humains par la force, ne pouvait naître nul droit, et qu’il était sans importance que l’usurpateur fut empereur d’Allemagne ou roi d’Angleterre.
À la lumière d’une loi fondamentale à la fois si certaine et précise, comment interpréter cette partie de l’article IV du traité de Paris :
De plus, S.M. Très-Chrétienne céde & garantit à Sa Majesté britannique, en toute propriété, le Canada […] & généralement tout ce qui dépend desdits pays, terres, îles et côtes, avec souveraineté, propriété, possession & tous droits […] que le Roi Très-Chrétien & la Couronne de France ont eus jusqu’à présent sur lesdits pays, îles, terres, lieux, côtes & leurs habitants.13
Sa Majesté Très-Chrétienne ne pouvait pas ne pas savoir qu’elle ne possédait pas ces territoires à titre patrimonial. Pire encore, elle ne pouvait pas ne pas savoir qu’elle n’était pas propriétaire des Canadiens. Pour sa part, Sa Majesté britannique, familière avec les lois fondamentales du royaume de France depuis la guerre de Cent Ans, savait d’expérience que son vis-à-vis français était inhabile à céder ses sujets sans leur consentement. Les deux souverains étaient donc conscients qu’ils contrevenaient à une loi intangible du royaume de France, ainsi qu’à l’ordre public international, en trafiquant des êtres humains. Ces seuls motifs suffisaient à priver l’article IV du traité de toute valeur légale, à le considérer nul et de nul effet, surtout quant à la dite transmission de la propriété des Canadiens. En conséquence, ce traité n’a pu priver les Canadiens de leur statut de sujets naturels français ni céder à Sa Majesté britannique une « souveraineté de droit » sur le Canada et les Canadiens.
Un domaine inaliénable et imprescriptible
À la doctrine de la consultation populaire, s’ajoute celle de l’inaliénabilité du domaine de la couronne. Cette doctrine, remontant elle aussi à l’époque féodale, fut adaptée par des romanistes qui avaient emprunté au droit romain la distinction entre le domaine du peuple, considéré comme inaliénable, et le domaine privé de l’empereur, considéré comme bien propre & patrimonial. Ainsi, les rois de France, pressés par le peuple et influencés par les romanistes, ont adopté cette distinction qui s’est transformée en loi fondamentale, lois que les rois ne pouvaient changer, sauf du consentement des États Généraux. De nombreux précédents historiques attestent de l’existence, de la précision et de la contraignabilité de cette loi fondamentale.14
La cession de territoires à titre de fiefs était, au Moyen-Âge, une entreprise délicate, car toute modification procédurale risquait de remettre en cause le principe du lien librement consenti entre un suzerain et son vassal. En conséquence, altérer le principe du contrat bilatéral risquait de saper un ordre politique où régnait en maître un rapport fondé sur la foi personnelle. Ce principe avait même un caractère international puisqu’il s’appliquait tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du royaume de France. Si, par exemple, il devait se produire une nécessité inéluctable – telle la perte d’une guerre contre un souverain déchaîné et intraitable – le roi de France restait inhabile à céder légalement quelque territoire ou partie de territoire sans la participation du pouvoir constituant du royaume. Cette règle du droit constitutionnel français était notoirement connue dans l’ensemble des chancelleries européennes. Voyons quelques exemples.
Ainsi, au début du XIVe siècle, avant que n’éclate la guerre de Cent Ans, Pierre de Cugnières, légiste au service de Philippe VI de Valois, soutient devant une assemblée de prélats et de barons que le roi de France est impuissant à aliéner les prérogatives de la couronne au motif qu’il n’en a pas la propriété. Non seulement le roi ne peut les aliéner mais, plus encore, il est tenu de poursuivre la révocation de celles déjà cédées en violation de la loi. Ce légiste met en lumière la double théorie de l’imprescriptibilité et de l’inaliénabilité des droits et prérogatives de la couronne. Il soutient que les pouvoirs du roi sont limités par la constitution, de sorte que ce dernier se trouve dans l'heureuse impuissance de s'amoindrir lui-même.15
Vers la même époque, la guerre de Cent Ans crée de nombreuses occasions de voir à l’œuvre le principe de « l’heureuse impuissance de s’amoindrir lui-même ». Le traité de Londres (mars 1359) et celui de Brétigny (octobre 1360) fournissent aux vassaux et bourgeois de plusieurs régions l’occasion de se révolter, créant ainsi un véritable climat de guerre civile, lorsque Jean II le Bon se mit à céder des territoires français à Édouard III d’Angleterre. Le chroniqueur Jean Froissart en fait état de la façon suivante : Combien que le roy les quitta de foy et d’hommage… disoient les aulcuns qu’il n’appartenait point à luy à quitter et que par droict il ne pouvait faire.
Vers la fin du XIVe siècle, la même conviction est exprimée dans un traité intitulé Le Songe du Vergier. L’auteur y affirme que l’inaliénabilité des droits de la couronne constitue une loi fondamentale du royaume : De rechief au roy appartient la souveraineté et le dernier ressort en tout son royaume, et entant qu’il ne pourroit cette souveraineté donner, transporter ou aultrement aliéner, car cette souveraineté et dernier ressort sont si forts et par telle manière annexés à la couronne qu’ils ne peuvent de luy estre séparés […] et que si un seigneur veult mettre sa terre et ses hommes en la subjection d’un autre seigneur, ses hommes se peuvent opposer et contredire, car c’est le prouffit des sujets de non changer de seigneur quand ils l’ont bon et agréable.16
Au cours de ce même siècle, suite aux prétentions dynastiques d’Édouard III d’Angleterre, le comte Robert III d’Artois affirme que la couronne de France n’est pas un bien patrimonial et que, pour cette raison, le roi ne peut en disposer : La couronne de France n’est pas un bien patrimoine (sic), nos princes n’en peuvent disposer, ils n’en ont que la jouissance, et personne ne la peut avoir que celui qui est appelé par les lois fondamentales.17
Au début du XVe siècle, le légiste Jean de Terre Rouge expose que la couronne de France n’est pas la propriété du roi, mais un fidéicommis dévolu à l’aîné de la maison royale, fidéicommis réglé par la force d’une coutume que nulle volonté souveraine ne peut modifier.18 La couronne de France, ni héréditaire ou testamentaire, est transmise à un successeur identifié par la constitution coutumière du royaume. Cette couronne est inaliénable et il n’existe aucune autre manière de la transmettre. Vers la fin du même siècle, Philippe Pot, diplomate et grand sénéchal de Bourgogne, propose une formule heureuse qui synthétise l’essence de cette royauté : La Royauté française est la dignité et non la propriété du prince.19 Cette dignité, loin d’être patrimoniale, est assimilée à une magistrature politique qui tire son origine de la souveraineté du peuple. La royauté française est donc la chose du peuple !
Une indignation inouïe lors du traité d’Utrecht
Les conférences préliminaires à la conclusion du traité d’Utrecht ont constitué le moment le plus dramatique de la mise à l’épreuve des lois fondamentales du royaume. Suite au décès, insolite, de trois Dauphins en moins d’une année, soit entre le 14 avril 1711 et le 8 mars 1712, le gouvernement anglais, fort alarmé d’une éventuelle réunion de couronnes de France et d’Espagne, exige, d’une part, la renonciation du duc d’Anjou [devenu Philippe V d’Espagne] à la couronne de France et, d’autre part, une semblable renonciation de la part des ducs de Berry et d’Orléans à la couronne d’Espagne. Pour se soumettre à ces exigences de l’Angleterre, la France se trouve face à un défi déchirant. Elle se devait d’ignorer ou de violer ses propres lois à la succession, lois jugées intangibles par tous les juristes français. Le marquis de Torcy et ses plénipotentiaires s’épuisent à faire entendre aux plénipotentiaires anglais la contradiction fragrante de leurs exigences à l’égard des lois fondamentales du royaume et la nullité manifeste des actes de renonciation exigés. Dans une lettre du 28 mars 1712 au vicomte de Bolinbroke, le marquis de Torcy expose :
Ce serait un bien de pouvoir mettre en usage l’expédient que vous proposez pour empescher à jamais le grand inconvénient de l’union des couronnes de France et d’Espagne. Mais il ne faut pas dans ces occasions bâtir sur du sable et prendre inutilement des précautions pour assurer des actes qui d’eux-même seraient nuls. En voulant éviter un mal on tomberait en d’autres plus dangereux […] Le roi de France n’est redevable de sa couronne ni au testament de son prédécesseur ni à aucun Édit ni à aucun décret, mais à la loy. Cette loy est regardée comme l’ouvrage de celuy qui a estably toutes les monarchies, et nous sommes persuadés en France que Dieu seul la peut abolir.20
Mais l’Angleterre, intraitable, est sûre de sa puissance. Elle ne veut rien céder sans la garantie des renonciations exigées. Le vicomte de Bolingbroke, secrétaire d’État aux négociations de paix, démontre que l’Angleterre est résolue à faire peu de cas des contraintes inhérentes au droit constitutionnel français :
Nous voulons bien croire que vous êtes persuadés en France que Dieu seul peut abolir la Loy sur laquelle votre droit à la succession est fondé, mais vous nous permettrez d’être persuadés dans la Grande-Bretagne qu’un prince peut se départir de son droit par une cession volontaire, et que celuy en faveur de qui cette renonciation se fait, peut être justement soutenu dans ses prétentions par les Puissances qui deviennent garantes du Traité. […]21
La réplique de Bolingbroke démontre l’inflexibilité de son gouvernement. La renonciation des princes français est présentée comme essentielle à la poursuite des conférences de paix. Le droit constitutionnel français, intangible depuis des siècles, doit se courber et se soumettre au dictat des Anglais. Quand il est question de guerre, l’Angleterre ne manque jamais d’énergie et de volonté. La France doit donc céder.
En 1712, après plus de douze ans de luttes défensives contre une coalition formée de huit puissances, le peuple français, vidé de son sang, brisé par les famines et la maladie, est réduit à l’impuissance. Le trésor public est à l’image du pays. Le roi, le peuple et le pays sont rendus à la dernière extrémité. Refuser de se soumettre au dictat des Anglais ne pourrait qu’ajouter la ruine au désastre d’un possible démembrement du royaume. La France doit faire acte d’humilité : les lois fondamentales du royaume seront donc violées.
Un tumulte d’indignation autour de l’enregistrement du traité d’Utrecht
Les formalités d’enregistrement du traité, le 15 mars 1713, démontrent avec éloquence que les conditions imposées par les Anglais ont ébranlé tout le monde. Les renonciations des ducs d’Anjou, de Berry et d’Orléans, les lettres patentes d’approbation du roi et les conclusions écrites du procureur général doivent être enregistrées au cours d’une séance solennelle au Parlement de Paris. Les juristes du royaume sont unanimes à dire que les renonciations des ducs sont nulles et de nul effet parce que contraires aux lois de succession au trône. Le chancelier de Pontchartrain désapprouve à ce point l’illégalité des renonciations qu’il fait défaut de paraître en personne. Le procureur général d’Arguesseau, tout aussi ébranlé, se fait représenter par l’un de ses avocats généraux. Le premier président du Parlement de Paris, Jean-Antoine de Mesnes, lit un avis officiel dans lequel le Parlement réitère que ces renonciations sont contraires aux lois fondamentales du royaume. Le doyen des conseillers laïques de la Grand’Chambre, Le Nain, se résigne à donner lecture des renonciations, des lettres patentes et des conclusions écrites du procureur général où il affirme que c’est au salut du peuple qu’il faut sacrifier ces lois fondamentales.22 Après quoi, le premier président de Mesnes reprend la parole et fait, du consentement du roi, une mise au point dramatique :
Que lorsque le Roy avait voulu lui faire part de cette résolution, il avait cru que le devoir de sa charge l’obligeait de prendre la liberté de représenter qu’une telle renonciation étoit absolument opposée aux lois fondamentales de l’Estat qui, depuis tant de siècles, règlent si heureusement l’ordre de la succession à la couronne. Que le Roy luy avoit fait l’honneur de répondre que personne n’avoit mieux senti que luy tout ce que l’on pouvoit dire et penser sur ce sujet.23
Quoi de plus insolite et déconcertant que d’entendre de la bouche du premier président de la plus haute cour de justice du royaume que seule la force vive d’un adversaire intransigeant avait forcé le roi à porter atteinte aux lois fondamentales de son royaume pour sauver le peuple du désastre qu’il était sur le point de subir aux mains des puissances coalisées. Les lois fondamentales avaient été honteusement violées, mais, d’une seule voix, la nation s’était levée contre ces conditions indécentes qui lui étaient imposées par un adversaire intransigeant qui avait l’impudence de mettre la toute- puissance de sa volonté au-dessus de tout. Mais les excès de cet adversaire ne s’arrêteront pas là. Il récidivera en 1763.
Les lois fondamentales et intangibles du royaume seront à nouveau violées pour mettre un terme à la guerre de Sept Ans. Toutefois, la nation ne bougera pas d’un iota. Pire encore, un espion à la solde des Anglais – Voltaire – se permettra l’indécence de s’en réjouir. Il faudra attendre deux siècles avant qu’un autre Français – Charles de Gaulle – ait la convenance de s’en scandaliser. Il s’agit du traité de Paris qui a fait du Canada et des Canadiens la propriété du roi d’Angleterre.
Le mutisme du roi, du Parlement et de la nation
La conclusion du traité de Paris soulève d’emblée, comme à Utrecht, de graves questions relatives à l’exercice des prérogatives du roi, dont celle de conclure des traités avec des puissances internationales. Le roi est, en principe, la seule autorité du royaume à pouvoir conclure des traités. Par contre, sa capacité à céder certains droits est rigoureusement balisée, sinon interdite par les lois fondamentales du royaume. Voici cette partie de l’article IV du traité de Paris où le roi, simple usufruitier, se comporte comme si le Canada et les Canadiens étaient un bien propre & patrimonial :
De plus, S. M. Très-Chrétienne [Louis XV] céde et garantit à Sadite Majefté Britannique [George III],en toute propriété, le Canada avec toutes fes dépendances, ainfi que l’isle du Cap-Breton, & toutes les autres isles & côtes dans le golfe & fleuve Saint-Laurent, & généralement tout ce qui dépend desdits pays, […] & leurs habitants […]24
Louis XV peut fort bien avoir eu – personnellement – l’intention de céder, en toute propriété, le Canada, ses dépendances, & leurs habitants, mais, comme à Utrecht, la question essentielle restait de savoir s’il en possédait la capacité légale. La réponse est pourtant aussi claire qu’elle l’était le 15 mars 1713 : cette fois encore, les lois fondamentales du royaume étaient en cause.
De plus, ces lois fondamentales étaient connues des souverains étrangers. En traitant avec le roi de France d’une cession ou d’une aliénation de quelque parcelle du domaine public, ces souverains savaient qu’ils concouraient à la création d’une entente portant en elle-même les germes de sa destruction. En droit international, George III aurait pu se croire autorisé à exercer une souveraineté de fait – mais non de droit ! – sur le Canada et les Canadiens, mais cette cession n’avait pas les mêmes conséquences en droit public français. Que Louis XV ait dû consentir à la cession de ces territoires – & de leurs habitants – sous la force vive des évènements, il n’en demeure pas moins que son consentement n’avait aucune valeur en droit français. Le domaine public français étant tout à la fois inaliénable et imprescriptible, la question de la souveraineté de droit sur les territoires cédés sous la contrainte est forcément demeurée ouverte depuis la conclusion du traité. Bref, tout ce qui avait été dit et fait lors de l’enregistrement du traité d’Utrecht aurait dû l’être en 1763.
Enfin, le seul écoulement du temps n’a pu transformer la souveraineté de fait – d’un roi pirate – en souveraineté de droit. À cet effet, juristes et publicistes en droit international coutumier ont été nombreux à dire et à répéter que lorsqu’il y a eu appropriation immorale d’un territoire, un siècle de possession injuste ne suffit pas pour enlever à celle-ci les vices de son origine !
Christian Néron
Membre du Barreau du Québec
Constitutionnaliste,
Historien du droit et des institutions.
RÉFÉRENCES :
- Rousseau, Charles, Cours de droit international public, rédigé d’après ses notes et avec son autorisation, rue St-Jacques, Paris-V, 1961-62.
- Association internationale Vitoria-Suarez, Contribution des théologiens au droit international moderne, Paris, Pedone, 278 p.
- Grotius, Hugues, Le droit de la guerre et de la Paix, Centre de philosophie politique et juridique, Caen, 1984, réimpression de l’éd. de 1724, Amsterdam, p. 945.
- Declareuil, J., « Le traité de Madrid et le droit public français », dans Recueil de législation de Toulouse, 2ième série, tome IX, 1913, p. 96.
- Declareuil, J., Histoire générale du droit français des origines à 1789, Léon Tenin, dir., Paris, p. 419.
- « Acte pour l’établissement de la Cie des Cent Associés pour le commerce du Canada », contenant les articles accordés par M. le Cardinal de Richelieu le 29 avril 1627, dans Edits, ordonnances royaux, déclarations et arrêts du Conseil d’Etat, Québec, E. R. Fréchette, 1854, p. 10.
- « Etablissements de la Cie des Indes Occidentales », dans Edits, ordonnances royaux, déclarations et arrêts du Conseil d’Etat, Québec, E. R. Fréchette, 1854, p. 46.
- Supra note 1, p. 106 et 107.
- Froissart, Jean, Chroniques, vol. 1, 141, tel que cité par Declareuil, supra note 5, p. 419.
- Supra note 2, p. 420.
- Olivier-Martin, Fr., Histoire du droit français des origines à la Révolution, 2ième tirage, Paris, Domat Montchrestire, p. 321.
- Bluntschli, Johann Gaspar, Le droit international codifié, 5ième éd., Paris, Guillaume et Cie, p. 177.
- Traité de Paris définitif entre la France, la Grande-Bretagne et l’Espagne, signé à Paris le 10 février 1763, The Consolidated Treaty Series, ed. by Clive Parry, vol. 42, 1760-1764, p. 286.
- Declareuil, supra note 5, p. 321.
- Prince Sixte de Bourbon de Parme, Le traité d’Utrecht et les lois fondamentales du royaume, thèse défendue en 1914, Paris, Communications et Tradition, 1998, p. 151 et 152.
- Le Songe du Vergier, cité par Sixte de Bourbon et par Declareuil, supra note 5, p. 419.
- Sixte de Bourbon, ibid., p. 153.
- Ibid., p., 155.
- Ibid., p., 163.
- Declareuil, supra note 5, p. 97.
- Ibid., p., 101.
- Ibid., p., 135.
- Ibid., p., 140.
- Supra note 13, p. 286.
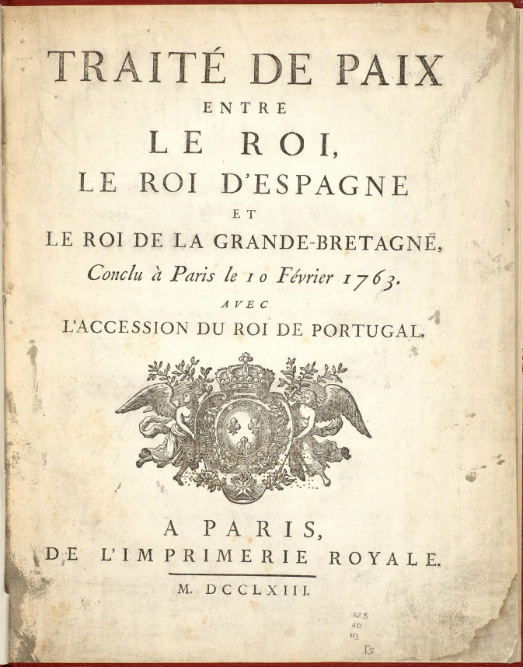



































Laissez un commentaire Votre adresse courriel ne sera pas publiée.
Veuillez vous connecter afin de laisser un commentaire.
2 commentaires
Me Christian Néron Répondre
29 octobre 2018RÉPONSE :
Ni le traité d'Utrecht pour les Acadiens, ni le traité de Paris pour les Canadiens,
n'ont eu des effets juridiques sur les ordonnances de 1627 et 1665.
En France, aucune autorité législative n'a pensé à les abroger non plus.
En droit, une loi reste une loi tant et aussi longtemps qu'elle n'a pas
été abrogée par l'autorité compétente. Donc, aux yeux de la loi, nous
sommes toujours des «« naturels françois »», c.-à-d. des ressortissants français.
D'ailleurs, un historien de l'Université de Rouen vient de terminer un essai sur le sujet.
( Manuscrit : « Français perdus ? » du 5 février 2018 ) L'historien démontre que les Acadiens,
à partir de 1755, et les Canadiens, à partir de 1763, ont toujours été reçus en France en tant
que Français. Il existe de très nombreux cas, bien documentés, qui vont jusqu'à 1814, et même
au-delà. Jamais aucune autorité française ne les a tenus pour étrangers.
Acadiens et Canadiens ont toujours eu droit au Fonds de secours pour réfugiés français.
Sous la Révolution, l'Assemblée nationale a voté à plusieurs reprises des argents pour ce Fonds.
Mais jamais un seul parlementaire ne s'est levé pour se demander : Ces gens-là sont-ils des Français ?
L'essai du professeur Baraton tarde à être publié. « Septentrion » semble l'avoir trouvé trop juridique
et trop technique. Quelqu'un a-t-il des connexions de ce côté ?
Lors du traité de Paris, Louis XV n'a pu céder qu'une souveraineté de fait sur le Canada.
Quant à la Proclamation royale de 1763, elle est illégale en partie, mais les Canadiens
d'alors n'avaient d'autre choix que de s'incliner devant la puissance du plus fort. Le droit
international ne reconnaît pas le droit de se soulever lorsqu'un peuple ne possède pas
une force suffisante pour renverser un usurpateur.
Un droit de résistance légitime existe toutefois contre la constitution « protestante » de 1982,
compte tenu que ce coup de force a eu pour objet de substituer une tradition juridique à une
autre. Ce coup de force ne porte pas uniquement sur les droits individuels. Il porte surtout sur
la façon protestante de concevoir la loi, le droit et la justice. Nous avons notre propre tradition
sur les droits individuels, mais elle nous vient du droit naturel classique qui cherche toujours
un juste équilibre entre le bien individuel et le bien commun. Ce qui n'existe pas dans le droit
anglo-protestant ! D'ailleurs, il n'existe même pas d'expression consacrée pour traduire l'idée
de bien commun. Il y a «« commonwealth »», mais l'expression ne fait référence qu'à la ri-
chesse commune. Bref, la constitution « protestante » de 1982 est un autre coup de colo-
nialisme juridique et politique.
Nous allons continuer sur ce sujet à l'occasion de notre prochain article : «« Les dessous de
l'afffaire Elvis Gratton »».
Marc Labelle Répondre
28 octobre 2018Fascinant tout cela. La Proclamation royale de la Couronne britannique du 7 octobre 1763, qui découle du traité de Paris du 10 février 1763, est donc elle aussi tant illégale qu’illégitime. Des questions surgissent.
Puisque nous avons été considérés comme de « vrais régnicoles et originaires françois » dès 1627, cela signifie-t-il que nous aurions le droit naturel inaliénable, par opposition à l’inhumaine réification, de réclamer aujourd’hui soit la citoyenneté française, soit la citoyenneté québécoise à créer en continuité, ou les deux, selon le principe de la souveraineté populaire française imprescriptible ?
En conséquence, le principe de « l’heureuse impuissance de s’amoindrir lui-même », ne rend-il pas illégale et révocable l’importation unilatérale en 1982 de l’étrangère Constitution canadienne adoptée originellement par le Parlement britannique — qui a alors notamment amoindrit les pouvoirs de l’Assemblée nationale — par les indignes Québécois Pierre Elliott Trudeau, Jean Chrétien et tutti quanti ?