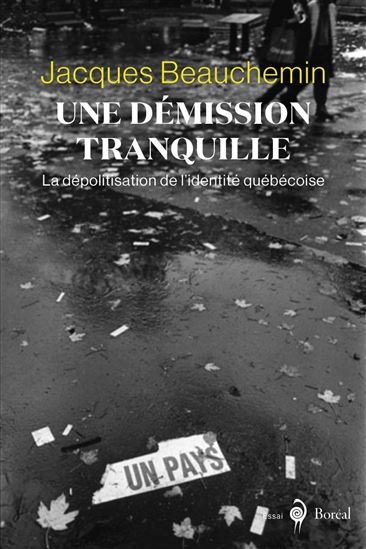Nous étions au Liban pour un Sommet de la Francophonie. Le premier ministre de l’époque, Jean Chrétien, avait choisi d’inaugurer une université que le gouvernement canadien avait aidée. Quoi de mieux en effet qu’une université pour symboliser la francophonie ? À la nuance près que dans cette université tous les cours se donnaient en… anglais !
Il faut dire qu’au Liban, faire des études supérieures signifie souvent étudier en anglais. La difficulté de faire des études supérieures dans sa langue maternelle est une des grandes caractéristiques des anciennes colonies. Rares sont en effet les pays d’Afrique, et même dans certaines régions d’Asie, où les études supérieures se déroulent dans la langue des autochtones. En cette ère de mondialisation, il faut la force d’une grande culture, française, allemande, espagnole ou japonaise, pour s’opposer à cette tendance de fond. Et encore.
Il n’est donc pas surprenant de constater que, depuis une bonne décennie, on assiste au Québec à un véritable engouement pour les études en anglais. Cela, on le sentait depuis longtemps malgré l’éternel déni d’une partie de nos élites. Dès 2010, une étude de l’Institut de recherche sur le français (IRFA) avait illustré la tendance d’un grand nombre de Québécois francophones ou allophones à s’intégrer culturellement au monde anglophone. Plus récemment, le chercheur Frédéric Lacroix (Les cégeps français à Montréal : le début de la fin ?L’Action nationale, février 2020) a montré qu’à Montréal en particulier les effectifs des cégeps anglais sont en croissance constante alors que ceux des cégeps français stagnent ou régressent. Cela permet évidemment aux premiers (et ensuite aux universités anglaises) de sélectionner les meilleurs candidats. Bref, de former les élites.
Cet engouement pour les études en anglais n’a rien d’étonnant. Ce qui l’est par contre, c’est que le Québec pousse le bouchon jusqu’à financer lui-même sa propre « bilinguisation », bref sa propre assimilation. En refusant d’appliquer la loi 101 au cégep, le Québec fait en effet figure d’exception parmi les minorités comparables dans le monde.
Le gouvernement catalan n’a pas la moitié des compétences et des budgets du gouvernement québécois, mais son système d’éducation est entièrement en catalan de la maternelle au seuil de l’université, à l’exception des cours de langue évidemment. Une réussite exceptionnelle si l’on tient compte du fait que le catalan n’est parlé dans le monde que par 10 millions de personnes et qu’il ne peut prétendre, comme le français (300 millions de locuteurs), au statut de grande langue internationale.
Dans les années 1960, les Flamands ont eux aussi choisi de « flamandiser » entièrement leur système scolaire, y compris l’université. En 1967, un mouvement semblable à celui de McGill français (qui voulait franciser l’université du même nom) se développa en Flandre. À la différence que, là-bas, il fut victorieux et provoqua le déménagement en territoire wallon de la section française de l’Université de Louvain.
Ces « petites nations » savent en effet que le bilinguisme institutionnel (à distinguer de l’apprentissage d’une langue seconde) est la porte ouverte à l’assimilation. Assimilation linguistique bien sûr, mais aussi et surtout culturelle. À ce propos, le niveau collégial occupe une place déterminante et irremplaçable. Il est à la fois ce lieu où les jeunes esprits se forment intellectuellement et le seul où la littérature a encore un certain droit de cité. Faire ses études collégiales en anglais, c’est se priver de ce moment où peut s’établir communion pour ainsi dire charnelle avec la littérature, le cinéma, la philosophie qui se font en français. C’est s’intégrer culturellement à un univers anglo-saxon, tant il est vrai qu’une langue n’est pas seulement un outil de communication, mais qu’elle charrie avec elle une histoire, une musique, une manière d’être, de penser, une façon de voir le monde. C’est pourquoi des esprits aussi fins et cultivés que le sociologue Guy Rocher et l’ancien chef du Parti québécois Bernard Landry ont défendu l’application de la loi 101 au cégep.
L’abandon de cette idée par toute la classe politique québécoise n’est certainement pas sans rapport avec cette Démission tranquille (Boréal) que décrit si bien Jacques Beauchemin dans un essai récent. Dans ce livre important, le sociologue montre comment les Québécois semblent délaisser progressivement les combats politiques pour en revenir à cette assurance trompeuse d’une sorte de permanence tranquille. Comme s’ils étaient là de toute éternité.
À droite, l’économie est devenue la mesure de toute chose. À gauche, l’enflure sociétale et la lutte pour « changer les mentalités » ne sont pas sans rappeler cette époque où le Québec voulait évangéliser le monde. Entre les deux, le combat politique semble en voie de disparition.
Or, écrit Beauchemin, « renoncer au statut de sujet politique et accepter la dépolitisation de notre être collectif annonce peut-être la folklorisation de notre collectivité. Un tel pronostic relève-t-il de la nostalgie, de la mélancolie ou du conservatisme ? Il pointe en tout cas en direction de ce qui aurait pu être et de ce qui semble nous échapper. »