Depuis quelques mois, les pronostics alarmistes se multiplient : Christine Lagarde énonce les « raisons d’être inquiets sur le front économique » et Jacques Attali que « le monde s’approche d’une grande catastrophe économique ». Les raisons de cette inquiétude sont variées, et, avant d’esquisser un schéma d’ensemble, il n’est pas inutile d’en faire la liste, un peu dans le désordre.
La croissance mondiale ralentit, principalement dans les pays émergents, hormis l’Inde. Ce phénomène s’autoalimente avec la baisse du prix des matières premières et se transmet aux pays avancés. Le commerce international ralentit lui aussi, au même rythme que le produit intérieur brut (PIB) mondial, comme si la mondialisation productive avait atteint un plafond. La zone euro enregistre une très timide et inégale reprise. Les Etats-Unis et le Royaume-Uni tirent leur épingle du jeu, mais la croissance tend à ralentir dans un cas et apparaît artificielle dans l’autre.
Du côté de la « sphère financière », le quantitative easing nourrit des bulles d’actifs plutôt que l’investissement productif, qui stagne. Et la seule perspective – jusqu’ici repoussée – d’une remontée des taux de la Fed pèse comme une épée de Damoclès qui suffit à déstabiliser les monnaies et les marchés financiers de nombreux pays. Bref, « l’incertitude et des forces complexes pèsent sur la croissance mondiale », pour reprendre la formule du Fonds monéyaire international (FMI) dans ses dernières perspectives.
De ce panorama pointilliste, on peut tirer trois caractéristiques essentielles de la conjoncture : l’économie mondiale est détraquée ; les « séquelles de la crise financière mondiale » (dixit Christine Lagarde) sont toujours présentes, sous forme de niveaux élevés d’endettement ; la stagnation séculaire menace : c’est la « nouvelle médiocrité », toujours selon Lagarde.
Au fondement de cette configuration, il y a l’épuisement des gains de productivité. Cette tendance n’est pas nouvelle, puisqu’elle s’est enclenchée au milieu des années 1980, avec de fortes fluctuations, notamment aux Etats-Unis. Or, la productivité, et plus directement la productivité globale des facteurs, est un élément essentiel de la dynamique du taux de profit. Ce dernier s’est pourtant rétabli dans les principaux pays capitalistes, en dépit de cet épuisement de la productivité.
Cette prouesse n’a pu être réalisée que par la mise en place de toute une série de dispositifs : financiarisation, endettement, inégalités, baisse de la part salariale, etc. Et grâce à la mondialisation productive, il était possible de capter une partie des gains de productivité spectaculaires réalisés dans les pays émergents. Dans le même temps, la raréfaction des occasions d’investissement rentable a conduit à une stagnation du taux d’investissement productif.
C’est ce modèle qui dérape en 2008. La gestion de la crise a été menée selon deux principes essentiels : ne pas solder les comptes (les « séquelles ») et reconstituer le modèle néolibéral, en cherchant à en contrôler les effets les plus délétères. Il s’agissait en pratique de garantir les droits de tirage acquis par le « 1 % » et la liberté d’action des banques et des multinationales.
Certaines des modalités de cette gestion de la crise sont en train de disparaître, d’autres se révèlent contre-productives. Le trait le plus important et le plus lourd de conséquences est sans doute l’incapacité de reconstituer la « Chinamérique », autrement dit l’axe qui structurait l’économie mondiale avant la crise.
La Chine est entrée dans une phase de transition, certes heurtée et difficile, vers un modèle de croissance centré sur la demande intérieure. Et les Etats-Unis ont pu réduire leur déficit commercial, en partie grâce à leurs nouvelles sources d’énergie. Cette rétraction, avec ses effets collatéraux sur les pays émergents et l’Europe, déséquilibre toute l’économie mondiale.
Parmi les pays avancés, on assiste à un écartèlement des taux de profit, à la fois entre les Etats-Unis et la zone euro et à l’intérieur de cette dernière. Ce phénomène implique un durcissement de la concurrence entre multinationales, susceptible de conduire à un repli général du taux de profit. C’est en tout cas ce qu’annonce l’Institut McKinsey qui prévoit que les profits des multinationales (global corporate profit) passeraient de 9,8 % du PIB mondial en 2013 à 7,9 % en 2025, retrouvant à peu près leur niveau de 1980.
Pendant ce temps, les politiques monétaires accommodantes ne réussissent pas à mordre sur l’activité réelle et nourrissent l’inquiétude et des sur-réactions fébriles des marchés financiers, qui ont déjà conduit à des crises de paiement dans les pays émergents dont ils se retirent brutalement.
Comprendre comment interagissent finance et production est une tâche essentielle mais difficile. Une récente étude d’économistes de la Banque des règlements internationaux (BRI) permet d’éclairer cette question en proposant un modèle qui relie les « causes financières » à leurs « effets réels ». Les auteurs construisent un indice mesurant la contribution de la répartition sectorielle de l’emploi à la croissance moyenne de la productivité. Puis ils montrent que cet indice est significativement corrélé (négativement) aux booms financiers. Autrement dit, quand le crédit augmente plus vite que le PIB, l’emploi se déplace vers les secteurs à productivité inférieure.
Ils montrent aussi que la valeur de cet indice avant une crise financière détermine la trajectoire ultérieure de la productivité. Et ce mécanisme est auto-entretenu, parce que le recours au crédit alimente ce qu’il est censé compenser, à savoir le ralentissement de la productivité. Cette modélisation des liens entre efficacité productive et dérives financières semble particulièrement pertinente pour analyser la crise de la zone euro.
Une chose est sûre à l’issue de ce (trop) rapide tour d’horizon : la « Grande récession » a ouvert une période de régulation chaotique à l’échelle mondiale. Une nouvelle crise semble aujourd’hui à peu près inévitable et il est difficile de discerner où se trouvera le point de rupture (Bourse, banques, changes ?), mais cet épisode sera en tout cas le marqueur de profondes contradictions structurelles.






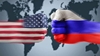




















Laissez un commentaire Votre adresse courriel ne sera pas publiée.
Veuillez vous connecter afin de laisser un commentaire.
Aucun commentaire trouvé