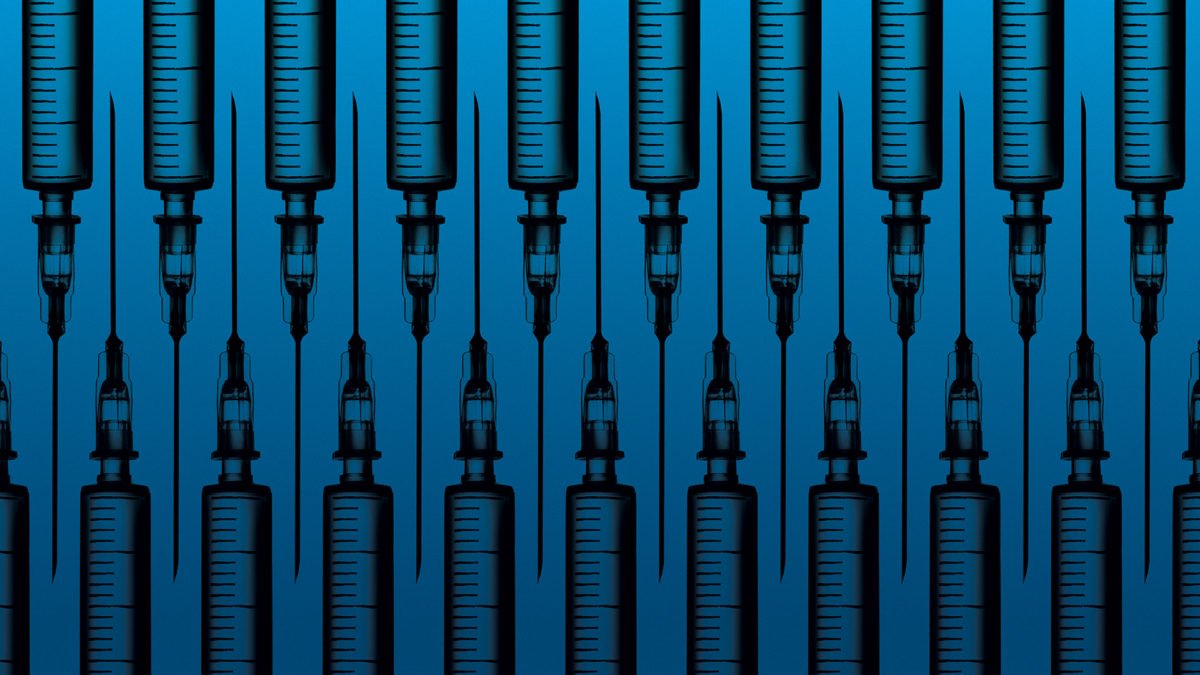Au bout du fil, Marc-André Langlois est un peu exaspéré. Depuis quelques semaines, ce chasseur de virus montréalais, qui enseigne au Département de biochimie, de microbiologie et d’immunologie de l’Université d’Ottawa, remue ciel et terre pour anéantir au plus vite la COVID-19, qui a déjà tué plus de 250 000 personnes dans le monde. Mais en ce samedi matin, le voilà qui perd « des heures et des heures » à remplir de la paperasse pour obtenir des permissions spéciales de l’Université. La mise en quarantaine du personnel compromet le nettoyage des labos et la livraison de précieux produits, comme des cellules de poumons provenant de donneurs d’organes. « On est quand même en train de concevoir un vaccin, ce n’est pas le moment de nous ralentir ! »
Afin de mettre le SRAS-CoV-2 à genoux, 99 projets de chercheurs travaillant dans des universités et des hôpitaux de recherche ont reçu de toute urgence des subventions d’Ottawa, pour un investissement total de 54,3 millions de dollars. C’est le financement le plus important accordé d’un seul coup par le fédéral pour écraser un virus, et ce, dans un temps record : normalement, il peut s’écouler un an, parfois plus, avant qu’un soutien soit versé dans le cadre d’un concours. Cette fois, le processus n’a duré qu’un mois.
La pédale est au fond partout sur la planète : plus de 250 essais cliniques sont en cours pour tester des vaccins, de nouveaux traitements ou des médicaments déjà existants susceptibles de soulager les victimes du coronavirus, selon la société de recherche et de données Informa Pharma Intelligence. Les scientifiques disposent de moyens financiers colossaux provenant des États et du secteur privé, comme ce don commun de 125 millions de dollars fait par la Fondation Bill et Melinda Gates, Mastercard et l’organisme caritatif Wellcome. « Avec cet argent, les labos pourront acheter, entre autres, des robots pour réaliser des tests, capables de fonctionner sept jours sur sept, nuit et jour, sans faire d’erreur. Ça accélère beaucoup le processus de recherche », soutient Marc-André Langlois.
Celui-ci a quant à lui reçu un million de dollars du fédéral pour deux ans. Une somme « correcte », considérant qu’il doit d’habitude répartir une subvention de cet ordre sur une période de cinq ans. « On va pouvoir aller plus vite. Mais si le gouvernement m’avait donné 50 millions de dollars il y a 10 ans, on aurait aujourd’hui tout un arsenal ! » Une entente avec une entreprise pharmaceutique qu’il ne peut nommer est sur la table, ce qui pourrait donner un autre coup de pouce à ses objectifs, soit produire un test qui dépisterait le coronavirus responsable de la COVID-19 en quelques minutes à peine et élaborer un traitement pour mettre le virus K.-O. Il planche aussi sur un vaccin sous forme de vaporisateur nasal, dont la composition comprend notamment des grains riz.
« Quand est-ce que ça va être prêt ? » Mon ton un peu pressant fait rire le sympathique chercheur de 45 ans. Disons qu’il a de la pression… « D’ici 12 à 18 mois. Dans la mesure où nos prototypes passent l’épreuve des études cliniques auprès des animaux, des gens en santé et des malades, puis l’évaluation par Santé Canada. » Ça peut paraître long comme horizon, alors que le virus a fauché tant de vies à ce jour. Mais c’est déjà un exploit de faire aussi vite sans compromettre la santé de la population.
Tout le monde s’échange de l’information. L’idée n’est pas de savoir qui sortira un vaccin en premier, mais lequel fonctionnera.
Pour ce qui est du test de dépistage et du médicament, Marc-André Langlois est à élaborer une approche axée sur les anticorps — « notre ligne de défense principale contre les agents pathogènes », explique-t-il. Puisque les anticorps humains mettent plusieurs semaines à anéantir le coronavirus (quand ils y parviennent), il mise plutôt sur ceux du… lama. C’est que les camélidés — une famille qui regroupe également les chameaux et les dromadaires — produisent des anticorps plus petits que ceux des autres mammifères, humains compris. Leur structure est aussi plus simple. « Plutôt que d’être faits de deux chaînes entrelacées comme des lacets de chaussure, ils n’ont qu’un seul lacet », illustre le chercheur. Ce qui comporte deux avantages. D’abord, ils sont plus faciles à cloner en laboratoire, une qualité bien utile quand on vise une production rapide. Ensuite, leur petite taille leur permettrait peut-être de s’accrocher plus facilement que nos propres anticorps à des surfaces du virus, une condition essentielle pour neutraliser l’ennemi.
Afin de produire ces valeureux combattants, l’équipe de Marc-André Langlois active le système immunitaire des lamas en injectant des protéines du coronavirus (les jolies bêtes élevées dans une ferme au Canada ne sont pas sacrifiées, insiste le chercheur — seul un peu de leur sang est prélevé). Les cellules générant les anticorps seront ensuite prélevées et clonées, dans le but notamment de produire un test ultrarapide de dépistage de la COVID-19. « On va coupler les anticorps à des molécules fluorescentes, puis les mettre en contact avec l’échantillon du patient. Si les anticorps se lient à l’échantillon, c’est que le virus est présent. » Le résultat est presque immédiat — quelques minutes à peine. « Notre test, dit immunologique, serait complémentaire aux tests actuels, qui détectent pour leur part des gènes du virus dans les prélèvements. Il permettrait aussi de distinguer les différentes souches de coronavirus, et même de reconnaître une nouvelle souche qui émerge. »
Le virologue croit également que les anticorps des lamas auraient le pouvoir d’entourer le coronavirus, de s’y agripper de tous bords tous côtés, ce qui l’empêcherait de s’attaquer aux cellules des poumons, sa cible de prédilection (les gens les plus gravement touchés par la COVID-19 souffrent d’une inflammation parfois fatale de l’appareil respiratoire).
« On veut donc fabriquer un agent thérapeutique à partir des anticorps qui ralentirait ou même freinerait l’infection. »
Cela dit, si le monde attend avec impatience un médicament qui traiterait enfin les symptômes parfois très violents de la COVID-19, l’arme avec un grand A demeure le vaccin, puisqu’il donnerait à notre organisme les munitions pour se défendre dès que le virus tenterait d’envahir nos cellules. Le labo de Marc-André Langlois planche aussi sur ce volet. « Le coronavirus va peut-être se résorber un peu cet été, mais il pourrait revenir plus tard, alors il faut absolument trouver le moyen d’immuniser la population. » Tous les laboratoires de virologie de la planète s’y affairent en ce moment, croit-il. Et dans un rare esprit de solidarité, en plus. « La recherche est un milieu très compétitif, parfois même toxique. Mais là, tout le monde s’échange de l’information. L’idée n’est pas de savoir qui sortira un vaccin en premier, mais lequel fonctionnera. Plus on est nombreux à essayer différentes approches, plus on est susceptibles de découvrir la bonne. »
Pour sa part, il concentre ses efforts sur l’une des protéines à la surface du virus — celle constituant les fameux pics qui donnent au SRAS-CoV-2 des allures de punk. Il veut l’utiliser pour stimuler le système immunitaire. « Certains vaccins sont composés du virus entier, rendu inoffensif grâce à la chaleur ou à un procédé chimique. Sauf que ce processus est risqué avec l’ennemi de l’heure. »
C’est du moins ce que laisse croire une découverte faite par des scientifiques il y a quelques années, après qu’ils eurent administré à des animaux un vaccin contre les coronavirus à l’origine du syndrome respiratoire aigu sévère de 2002 et du syndrome respiratoire du Moyen-Orient, en 2012. Plutôt que de protéger contre l’assaillant, le vaccin exacerbait l’inflammation des poumons. « Imaginez si des millions de personnes l’avaient reçu, dit le virologue. Ça aurait été la catastrophe. »
La protéine ciblée par l’équipe de Marc-André Langlois, qui compte une vingtaine de scientifiques, est peu coûteuse et facile à produire en grande quantité : il s’agit de l’introduire dans le matériel génétique d’une plante — le riz et le tabac, dans ce cas-ci — et d’en faire la culture. « Ensuite, on broie les feuilles de tabac ou les grains de riz en fine poudre, qu’on met dans un vaporisateur nasal. » L’inhalation de cette espèce de « pollen » de coronavirus devrait déclencher la production d’une armée d’anticorps par les cellules B, qui sont notre mémoire immunitaire — une fois qu’elles ont combattu avec succès un agent pathogène, ces précieuses alliées se souviennent de ses points faibles et ne le laissent pas s’en prendre encore à nous.
Le virologue mise sur le vaporisateur nasal plutôt que sur la traditionnelle piqûre dans le bras, en raison de l’aversion que suscite l’aiguille. « Il y en a qui ont peur, qui trouvent ça trop invasif… Le but est de convaincre le plus de gens possible de se faire vacciner, pour atteindre l’immunité de groupe. »
Pas de confinement pour les travailleurs du chantier de l’usine de l’entreprise biopharmaceutique Medicago, dans le secteur D’Estimauville, à Québec. En ce début avril, ce sont à peu près les seuls employés de la construction de la province qui ont encore le droit de jouer de la scie et de la perceuse. Il faut dire que leur mission est urgente : construire une installation en mesure de produire 50 millions de doses de vaccin par année.
« On fait le plus vite qu’on peut, vous imaginez nos journées », raconte Nathalie Landry, vice-présidente directrice des affaires scientifiques et médicales à Medicago. Cette entreprise de 465 employés peu connue du grand public a pris tout le monde par surprise en annonçant qu’elle s’affairait à la création d’un vaccin contre le coronavirus, le 12 mars dernier. Un traitement pour soigner les malades est aussi en préparation, avec la collaboration de Gary Kobinger, un chercheur de réputation mondiale travaillant au Centre de recherche en infectiologie de l’Université Laval, à Québec. « Il est en train d’analyser des échantillons biologiques de personnes ayant guéri de la COVID-19, dans le but de trouver les anticorps qui ont pu neutraliser le virus, explique la scientifique. Reste à voir comment on peut produire un médicament à partir de ces anticorps-là. »
Ça fait longtemps qu’on connaît l’influenza, on sait ce qui a tendance à nous en protéger. Tandis que cette souche de coronavirus est nouvelle pour l’homme.
Pour ce qui est du vaccin, les essais ont commencé début avril sur des souris, puis se feront sur des singes. Si tout va bien, ce sera au tour des humains en juillet. En vue d’aider Medicago à accélérer les recherches, le gouvernement du Québec lui a versé sept millions de dollars à la fin du mois de mars. Ottawa aussi a mentionné « soutenir » l’entreprise, sans toutefois préciser la nature de son appui. Cela dit, ces sommes ne feront pas de miracle : comme pour les autres études en cours sur la planète, un délai d’un an, un an et demi est à prévoir avant d’aboutir à une solution, évalue Nathalie Landry.
La société biopharmaceutique a cependant bon espoir de réussir son pari, puisqu’elle s’appuie sur une technologie qu’elle développe depuis 20 ans, et qui a fait ses preuves — d’ici la fin de l’année, un vaccin contre le virus responsable de la grippe saisonnière devrait d’ailleurs être commercialisé. « On a fait huit études cliniques depuis 2009, auprès de 26 000 patients, donc c’est très solide », dit Nathalie Landry. Ne manque que la bénédiction de Santé Canada, qui étudie présentement la demande d’homologation.
Les chercheurs de Medicago appliqueront la même formule pour mettre au point le vaccin contre la COVID-19. En gros, il s’agit d’introduire par infiltration du matériel génétique d’un virus dans les feuilles d’une plante de tabac australienne réputée pour sa robustesse, la Nicotiana benthamiana. Avant que la plante ne détruise le corps étranger grâce à son système immunitaire, donc pendant la période d’incubation, elle produit des protéines qui constituent l’ingrédient clé de la recette. « À ce moment, on récolte les feuilles pour en faire une espèce de soupe verte, qu’on filtrera ensuite pour retirer les débris et contaminants, jusqu’à obtenir un vaccin pur et stérile sous forme de particules dites pseudovirales », explique Nathalie Landry. Ces fameuses particules ont l’effet d’un appelant de canard à la chasse : elles déclenchent les tirs de nos anticorps, qui pensent avoir un véritable microbe dans leur ligne de mire. S’ensuit un heureux carnage.
Techniquement, tout porte à croire que le stratagème serait aussi fatal pour le SRAS-CoV-2 que pour les microbes qui causent la grippe. « Mais il faut accumuler les preuves, dit la vice-présidente. Ça fait longtemps qu’on connaît l’influenza, on sait ce qui a tendance à nous en protéger. Tandis que cette souche de coronavirus est nouvelle pour l’homme. »
Si l’astuce fonctionne, Medicago sera en mesure de commencer sans tarder la production de vaccin, et ce, de manière industrielle. Les plants de tabac poussent vite — il s’agit d’en faire la culture à grande échelle. « Ce n’est pas la première fois que l’entreprise relève pareil défi, précise Nathalie Landry. En 2012, une agence du département de la Défense américaine nous a demandé de fabriquer 10 millions de doses de vaccin contre la grippe en 30 jours, dans nos installations de la Caroline du Nord. Et on a réussi. »
Medicago est en encore meilleure posture aujourd’hui, puisque deux autres usines sont en construction à Québec. Elles ne seront pas fonctionnelles avant deux ou trois ans, mais d’ici là, son usine-pilote, située dans le parc technologique de Québec, peut produire jusqu’à deux millions de doses par mois, selon les projections. « Ensuite, ce sera au gouvernement et aux autorités en santé publique de choisir qui devra être immunisé en premier. Ils pourraient cibler le personnel soignant et les personnes à risque, par exemple. »
«Vas-y, Denis, on fonce avec toi ! » Les quatre scientifiques que dirige le virologue Denis Leclerc, au Centre hospitalier universitaire de Québec, ont répondu avec enthousiasme quand il a proposé de suspendre toutes les activités pour tâcher d’« étouffer le coronavirus ». Il faut dire que le professeur à la Faculté de médecine de l’Université Laval a bien des raisons d’espérer sauver des vies : la méthode qu’il a élaborée pour produire des vaccins est « rapide, efficace et sécuritaire », assure-t-il. En tout cas, Ottawa a jugé son concept assez convaincant pour lui octroyer un financement d’urgence — plus de 700 000 dollars. « C’est l’occasion de montrer à quel point notre outil, qui est le fruit de 15 ans de recherche, est utile pour résoudre les épidémies. À force de faire des essais-erreurs, on a trouvé une solution vraiment optimale. »
Sa technologie repose sur une nanoparticule, une toute petite molécule fabriquée en laboratoire. Elle est faite d’une protéine issue du virus de la mosaïque du papayer, l’arbre qui donne la papaye, et d’un brin d’acide nucléique, lequel sert de charpente. « Ça a l’apparence d’un minituyau d’arrosage dont la fonction est de survolter le système immunitaire, explique Denis Leclerc. C’est comme un leurre à la pêche : ce n’est pas un virus, mais ça lui ressemble à tel point que le corps se met à produire des anticorps. »
Des épidémies, il va y en avoir d’autres, c’est certain. Mais la prochaine fois, on sera prêts.
C’est en travaillant au grand rêve de sa carrière de chercheur, soit la création d’un vaccin qui combattrait d’un coup toutes les souches du virus de la grippe, qu’il a conçu cette nanoparticule, qui sert surtout de plateforme, de véhicule. « Il faut la coupler à un morceau d’agent pathogène, comme le SRAS-CoV-2, pour que le système immunitaire passe vraiment en mode attaque », précise le virologue.
Les nanoparticules ont l’avantage de pouvoir être entreposées pendant des années, alors que les composants de nombreux vaccins ont une durée de vie d’à peine quelques mois. « Ça veut dire qu’on pourrait en stocker des millions de doses en prévision de la prochaine épidémie. » Elles sont aussi « extrêmement sécuritaires », insiste Denis Leclerc. Il en a fait la démonstration il y a quatre ans, lors d’une étude clinique auprès de six groupes de huit participants chacun. « On avait jumelé la nanoparticule au vaccin saisonnier contre la grippe et ça a été très bien toléré. »
Le vaccin de Denis Leclerc favoriserait la prolifération des cellules T — ces alliées naturelles capables de reconnaître et de détruire nos cellules infectées — tout en empêchant le virus d’infecter les cellules humaines. « Une combinaison robuste », dit-il. Mais avant de crier victoire, il faut d’abord tester la formule, voir si la chimie va opérer entre la nanoparticule et les morceaux de coronavirus synthétiques qui y seront jumelés. Et choisir les bons morceaux de virus — en mots savants, les bons antigènes. C’est que certains risquent de former des agrégats avec la nanoparticule, et donc d’en changer la forme. « Le résultat final doit ressembler à un virus, sinon le système immunitaire ne réagira pas. »
On vérifiera ensuite la résistance de la formule à la chaleur, afin que les vaccins puissent être entreposés à température ambiante dans des pays où la réfrigération est un luxe, comme dans certaines régions de l’Afrique. On devra aussi s’assurer que l’ajout de sel à la recette (un ingrédient essentiel, puisque les vaccins reposent dans des liquides isotoniques semblables à ce qu’il y a dans le corps humain) ne nuit pas à la stabilité du produit. S’ensuivront les tests d’usage auprès des animaux et des humains.
Bref, la solution du virologue n’est pas pour demain — il faudra possiblement attendre 18 mois. Mais si son concept fonctionne, les microbes n’auront qu’à bien se tenir. « La beauté de ma nanoparticule, c’est qu’elle peut s’adapter à n’importe quel virus. On pourra élaborer un vaccin dès qu’on aura décodé le matériel génétique de l’agent pathogène, ce qui prend quelques jours d’habitude. Des épidémies, il va y en avoir d’autres, c’est certain. Mais la prochaine fois, on sera prêts. »
Vous avez aimé cet article ? Pendant cette crise, L’actualité propose gratuitement tous ses contenus pour informer le plus grand nombre. Plus que jamais, il est important de nous soutenir en vous abonnant (cliquez ici). Merci !