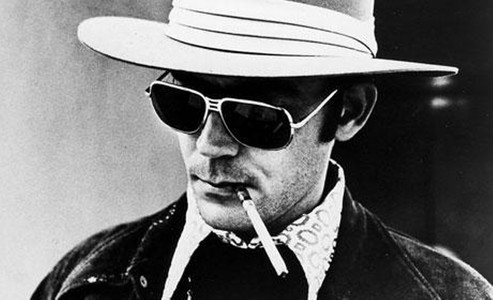La réalisation de l’indépendance nécessite-t-elle d’instituer l’autorité politique du peuple québécois ?
21 mars 2017
Réponse :
Vous soulevez des questions qui m'intéressent beaucoup.
Je me promets d'y revenir - de façon analytique - pour
expliquer les deux visions juridiques du monde occidental
depuis la Réforme.
Au Québec, nous avons hérité de celle de l'Ancien Régime,
alors qu'au Canada ils ont hérité de celle du protestantisme,
elle-même héritée de la vision judaïque du droit, ce qui a eu
pour effet :
1. de dévaloriser le droit en le confondant avec la morale ;
2. de dévaloriser la raison au profit de la volonté ;
3. de durcir la notion de positivisme juridique ;
4. de faire de la sanction un élément essentiel de la règle
de droit.
Pour le moment, je continue sur les « faits » de la Confédération.
Ensuite, je vais aborder les idées.
En abordant les idées, je veux démonter que le Québec est,
en quelque sorte, un «« village athénien au milieu d'Israël »»,
et que ce rapport risque de se terminer en faveur d'Israël,
indépendance ou pas.