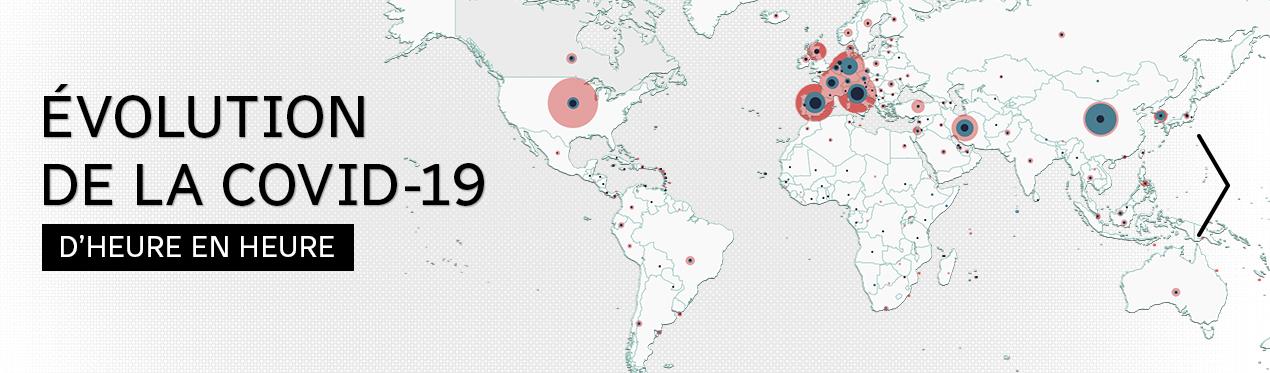Au-delà de l’urgence sanitaire, Alain Deneault pense que la pandémie du coronavirus, aussi douloureuse soit-elle, doit être l’occasion pour la planète d’observer une halte salvatrice et de repenser son modèle de production et de consommation.
Le philosophe est sans détour. Dans la fièvre du coronavirus qui s’empare du monde, avec son lot de morts et d’effets collatéraux, il est naturel de s’allier solidairement pour faire front commun à la pandémie, mais il faut se garder de verser dans un optimisme béat.
Il recommande de ne pas trop se gargariser de slogans triomphants, du genre Tout ira bien
, car, prévient-il, non, tout n’ira pas bien si on continue comme on l’a fait. C’est la leçon qu’il faut tirer, il ne faut pas se fermer les yeux en disant : tenons bon et bientôt tout continuera comme avant.
En entrevue à l’émission Désaultels le dimanche, le professeur de philosophie à l’Université de Moncton prône une espèce de catharsis en ces temps de crise. C’est un moment existentiel, c’est un moment aussi intellectuel où on peut collectivement se demander d’où on vient et où on va. Et qu’est-ce qu’on fait, comment on s’organise et comment s’explique la crise dans laquelle on est?
En d’autres termes, il faudrait faire du problème un élément déclencheur pour penser plus largement notre rapport au monde
.
La fulgurance avec laquelle le virus, originaire d’une ville chinoise, s’est propagé dans le monde a mis à nu les failles de notre système économique mondialisé, soutient-il.
On a complètement intégré, par la délocalisation des entreprises, toutes les parties du monde à un même réseau de production. Ce qui suppose énormément de rapports de dépendance et d’interdépendance.
Aujourd’hui, l’organisation du travail, la production capitaliste est tellement réseautée à l’échelle mondiale que lorsqu’un Chinois éternue, la planète devient malade.
Le chaos mondial auquel on assiste a également révélé que les tenants du capitalisme peuvent s’avérer des géants aux pieds d’argile. On est dans un moment où on se rend compte que la mondialisation financière est très fragile. Elle n’est pas assise sur du roc, comme on a pu le penser.
Mettre le capitalisme sur pause
Il est bon que la planète fasse une halte
, clame l’auteur de La médiocratie. On se rend compte qu’on est malheureux au travail très souvent. En témoignent le recours aux psychotropes, l’alcoolisme et grand nombre de phénomènes sociaux qu’on observe.
Le modèle économique capitaliste a été pensé pour pouvoir faire travailler des gens dans des conditions de misère, pour contourner les règles sociales que nous sommes données dans la modernité, en Occident
, déplore le philosophe.
La logique productiviste et l’obsession de la croissance exercent par ailleurs une pression insoutenable sur les ressources naturelles.
On voit que la planète ne peut continuer à soutenir ce qu’on exige d’elle au titre du capitalisme. Ce régime dans lequel on est, de toute façon, ne pourra pas durer. Il n’y aura pas éternellement des écosystèmes capables de subir les assauts de la grande industrie, il n’y aura pas continuellement des richesses naturelles, dans le domaine énergétique ou minier, capables de satisfaire une demande absolument goulue, absolument folle.
Les incendies de forêt, la déforestation galopante, la fonte des glaciers, l’érosion des sols, les ouragans, les tsunamis sont, de l’avis du philosophe, autant de signaux de détresse auxquels il convient d’être attentif.
On a énormément de signes qui montrent que, non, tout n’ira pas bien si on continue comme on le fait. Il faut vraiment saisir cette occasion pour travailler à une régionalisation des modes d’organisation et à une modération de notre rapport à la consommation.
Le tourisme de masse n’est pas en reste. Il est en cause en ce sens qu’il représente un gaspillage éhonté et polluant de richesses non renouvelables
.
En somme, ce mode de vie là n’est pas viable à long terme, il faudra l’abroger.
Un changement de paradigme s'impose
Il y a lieu de redéfinir l’économie de manière à ce qu’elle ne soit plus au service d'une oligarchie d’actionnaires
, affirme-t-il. Car, de nos jours, il est à peu près impossible de penser une action sociale sans se définir par rapport à un marché qui est largement organisé pour satisfaire les détenteurs de capitaux et cette classe de grands actionnaires
.
L’urgence nécessite un changement de paradigme. Il faudra changer de régime au 21e siècle. C’est ça que nous disent les événements, pas seulement cette pandémie, mais les incendies de forêt, les crises de verglas, les invasions d’insectes, les tsunamis
.
Il est temps de rompre avec un système qui est faux
, qui n’est pas viable
, et lui substituer d’autres modes d’organisation
. Tout cela devrait se faire dans la concertation, sinon on sera dans une sorte de lutte ouverte comme on commence à le voir se manifester sur un mode violent et brutal ici ou là. La réaction de Donald Trump par rapport à cet achat de masques par les Canadiens montre bien dans quelle relation tendue on s’oriente
.
Il faudra rapidement développer des formes d’organisation qui sont frugales, humbles, mesurées et régionales et s’en tenir à une production, à une consommation beaucoup plus réduite, mais peut-être beaucoup plus significative et sensée que par le passé si on veut éviter une guerre ouverte, un cataclysme.
Cette pandémie, on le voit bien, souligne-t-il, se moque des frontières, des différences sociales et ethniques. Tout le monde est concerné
et devrait saisir la chance de passer à un autre régime, plus humble, plus frugal, plus mesuré, à des échelles qui ont plus de sens : ne pas faire fabriquer en Chine des objets de première commodité qu’on pourrait très bien produire nous-mêmes par exemple.
De plus, ce rapport-là au monde est l’occasion de développer des compétences, des talents, de se révéler à soi-même, de prendre conscience d’atouts et de forces qu’on a et qui sont aujourd’hui étouffés dans un rapport au marché qui est totalement aliénant, qui est infantilisant, et qui consiste toujours à produire à un rythme fou des produits dont, souvent, on n’a pas vraiment besoin, qui sont polluants, auprès d’un public qui n’en veut pas vraiment et qu’il faut convaincre, et séduire par l’appât du marketing, d’acheter, dans une sorte de grand délire auquel il faudra mettre fin
.